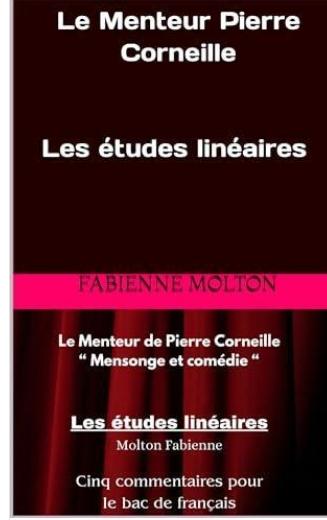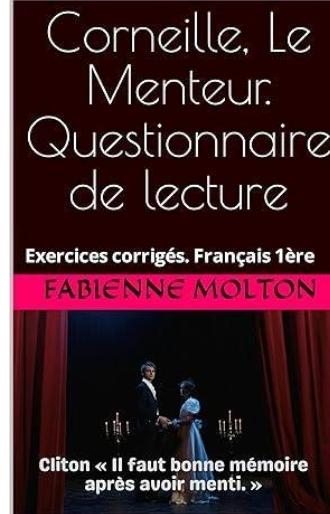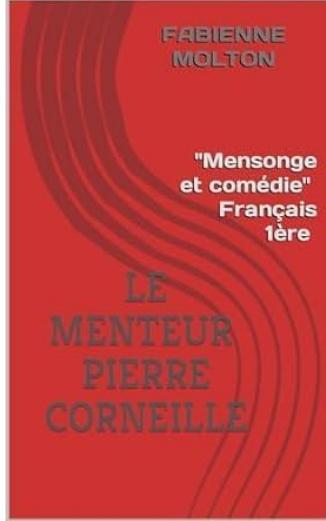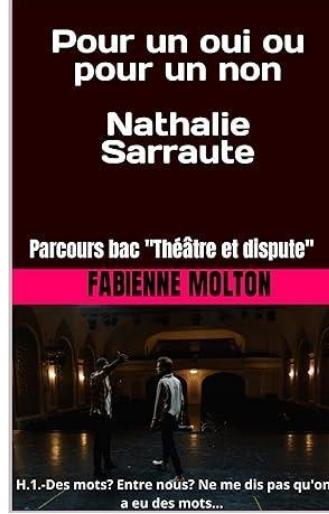Manuel de philosophie : ÉPISTÉMOLOGIE ( La raison et le réel) la démonstration avec Leibniz, Aristote et Pascal
- Le 04/01/2019
- Dans Le manuel de philosophie. Les textes du bac
- 0 commentaire

ÉPISTÉMOLOGIE ( La raison et le réel) - la démonstration -
LA DÉMONSTRATION
Il faut d'abord établir quel est le sujet de notre enquête et de quelle discipline elle relève : son sujet, c'est la démonstration, et c'est la science démonstrative dont elle dépend. Ensuite nous devons définir ce qu'on entend par prémisse, par terme, par syllogisme. La prémisse est le discours qui affirme ou qui nie quelque chose de quelque chose, et ce discours est soit universel, soit particulier, soit indéfini. J'appelle universelle, l'attribution ou la non-attribution à un sujet pris universellement ; particulière, l'attribution ou la non-attribution à un sujet pris particulièrement ou non universellement ; indéfinie, l'attribution ou la non-attribution faite sans indication d'universalité ou de particularité: par exemple, les contraires rentrent dans la même science ou le plaisir n'est pas le bien. J'appelle terme ce en quoi se résout la prémisse, à savoir le prédicat et le sujet dont il est affirmé, soit que l'être s'y ajoute, soit que le non-être en soit séparé. Le syllogisme* est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Par le seul fait de ces données : je veux dire que c'est par elles que la conséquence est obtenue ; à son tour, l'expression c'est par elles que la conséquence est obtenue signifie qu'aucun terme étranger n'est en plus requis pour produire la conséquence nécessaire."
Aristote, Organon, livre III
Et je n'ai choisi cette science [la géométrie] (...) que parce qu'elle seule sait les véritables règles du raisonnement, et, sans s'arrêter aux règles des syllogismes qui sont tellement naturelles qu'on ne peut les ignorer, s'arrête et se fonde sur la véritable méthode de conduire le raisonnement en toutes choses, que presque tout le monde ignore, et qu'il est si avantageux de savoir, que nous voyons par expérience qu'entre esprits égaux et toutes choses pareilles, celui qui a de la géométrie l'emporte et acquiert une vigueur toute nouvelle. Je veux donc faire entendre ce que c'est que démonstration par l'exemple de celles de géométrie, qui est presque la seule des sciences humaines qui en produise d'infaillibles, parce qu'elle seule observe la véritable méthode, au lieu que toutes les autres sont par une nécessité naturelle dans quelque sorte de confusion que les seuls géomètres savent extrêmement reconnaître. Cette véritable méthode qui formerait les démonstrations dans la plus haute excellence, s'il était possible d'y arriver, consisterait en deux choses principales : l'une, de n'employer aucun terme dont on n'eût auparavant expliqué nettement le sens, l'autre, de n'avancer jamais aucune proposition qu'on ne démontrât par des vérités déjà connues : c'est-à-dire, en un mot, à définir tous les termes et à prouver toutes les propositions.
Blaise Pascal, Oeuvres complètes
 Les bêtes sont purement empiriques et ne font que se régler sur les exemples, car elles n’arrivent jamais à former des propositions nécessaires, autant qu’on en peut juger ; au lieu que les hommes sont capables des sciences démonstratives. C’est encore pour cela que la faculté que les bêtes ont de faire des consécutions est quelque chose d’inférieur à la raison qui est dans les hommes. Les consécutions des bêtes sont purement comme celles des simples empiriques, qui prétendent que ce qui est arrivé quelquefois arrivera encore dans un cas où ce qui les frappe est pareil, sans être capables de juger si les mêmes raisons subsistent. C’est par là qu’il est si aisé aux hommes d’attraper les bêtes, et qu’il est si facile aux simples empiriques de faire des fautes. C’est de quoi les personnes devenues habiles par l’âge et par l’expérience ne sont pas exemptes lorsqu’elles se fient trop à leur expérience passée, comme il est arrivé à plusieurs dans les affaires civiles et militaires, parce qu’on ne considère point assez que le monde change et que les hommes deviennent plus habiles en trouvant mille adresses nouvelles, au lieu que les cerfs ou les lièvres de ce temps ne deviennent point plus rusés que ceux du temps passé. Les consécutions des bêtes ne sont qu’une ombre du raisonnement, c’est-à-dire ce ne sont que connexions d’imagination, et que passages d’une image à une autre, parce que dans une rencontre nouvelle qui paraît semblable à la précédente, on s’attend de nouveau à ce qu’on y trouvait joint autrefois, comme si les choses étaient liées en effet, parce que leurs images le sont dans la mémoire. Il est vrai qu’encore la raison conseille qu’on s’attende pour l’ordinaire à voir arriver à l’avenir ce qui est conforme à une longue expérience du passé, mais ce n’est pas pour cela une vérité nécessaire et infaillible, et le succès peut cesser quand on s’y attend le moins, lorsque les raisons changent qui l’ont maintenu. C’est pourquoi les plus sages ne s’y fient pas tant qu’ils ne tâchent de pénétrer quelque chose de la raison (s’il est possible) de ce fait pour juger quand il faudra faire des exceptions. Car la raison est seule capable d’établir des règles sûres et de suppléer ce qui manque à celles qui ne l’étaient point, en y insérant leurs exceptions ; et de trouver enfin des liaisons certaines dans la force des conséquences nécessaires, ce qui donne souvent le moyen de prévoir l’événement sans avoir besoin d’expérimenter les liaisons sensibles des images, où les bêtes sont réduites, de sorte que ce qui justifie les principes internes des vérités nécessaires distingue encore l’homme de la bête.
Les bêtes sont purement empiriques et ne font que se régler sur les exemples, car elles n’arrivent jamais à former des propositions nécessaires, autant qu’on en peut juger ; au lieu que les hommes sont capables des sciences démonstratives. C’est encore pour cela que la faculté que les bêtes ont de faire des consécutions est quelque chose d’inférieur à la raison qui est dans les hommes. Les consécutions des bêtes sont purement comme celles des simples empiriques, qui prétendent que ce qui est arrivé quelquefois arrivera encore dans un cas où ce qui les frappe est pareil, sans être capables de juger si les mêmes raisons subsistent. C’est par là qu’il est si aisé aux hommes d’attraper les bêtes, et qu’il est si facile aux simples empiriques de faire des fautes. C’est de quoi les personnes devenues habiles par l’âge et par l’expérience ne sont pas exemptes lorsqu’elles se fient trop à leur expérience passée, comme il est arrivé à plusieurs dans les affaires civiles et militaires, parce qu’on ne considère point assez que le monde change et que les hommes deviennent plus habiles en trouvant mille adresses nouvelles, au lieu que les cerfs ou les lièvres de ce temps ne deviennent point plus rusés que ceux du temps passé. Les consécutions des bêtes ne sont qu’une ombre du raisonnement, c’est-à-dire ce ne sont que connexions d’imagination, et que passages d’une image à une autre, parce que dans une rencontre nouvelle qui paraît semblable à la précédente, on s’attend de nouveau à ce qu’on y trouvait joint autrefois, comme si les choses étaient liées en effet, parce que leurs images le sont dans la mémoire. Il est vrai qu’encore la raison conseille qu’on s’attende pour l’ordinaire à voir arriver à l’avenir ce qui est conforme à une longue expérience du passé, mais ce n’est pas pour cela une vérité nécessaire et infaillible, et le succès peut cesser quand on s’y attend le moins, lorsque les raisons changent qui l’ont maintenu. C’est pourquoi les plus sages ne s’y fient pas tant qu’ils ne tâchent de pénétrer quelque chose de la raison (s’il est possible) de ce fait pour juger quand il faudra faire des exceptions. Car la raison est seule capable d’établir des règles sûres et de suppléer ce qui manque à celles qui ne l’étaient point, en y insérant leurs exceptions ; et de trouver enfin des liaisons certaines dans la force des conséquences nécessaires, ce qui donne souvent le moyen de prévoir l’événement sans avoir besoin d’expérimenter les liaisons sensibles des images, où les bêtes sont réduites, de sorte que ce qui justifie les principes internes des vérités nécessaires distingue encore l’homme de la bête.
Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain
L’intuition est le principe de la science et le « principe des principes » : Quant aux habitus de l’entendement par lesquels nous saisissons la vérité, puisque les uns sont toujours vrais et que les autres sont susceptibles d’erreur, comme l’opinion, par exemple, et le raisonnement, la science et l’intuition étant au contraire toujours vraies ; que, d’autre part, à l’exception de l’intuition, aucun genre de connaissance n’est plus exact que la science, tandis que les principes sont plus connaissables que les démonstrations, et que toute science s’accompagne de raisonnement : il en résulte que des principes il n’y aura pas science. Et puisque, à l’exception de l’intuition, aucun genre de connaissance ne peut être plus vrai que la science, c’est une intuition qui appréhendera les principes. Cela résulte non seulement des considérations qui précèdent, mais encore du fait que le principe de la démonstration n’est pas lui-même une démonstration, ni par suite une science de science. Si donc nous ne possédons en dehors de la science aucun autre genre de connaissance vraie, il reste que c’est l’intuition qui sera principe de la science. Et l’intuition est principe du principe lui-même, et la science tout entière se comporte à l’égard de l’ensemble des choses comme l’intuition à l’égard du principe.
Aristote, Seconds analytiques, II, 19
Intuition et déduction sont les deux sources de toute connaissance rigoureuse : Mais, pour ne pas tomber dans la même erreur, rapportons ici les moyens par lesquels notre entendement peut s’élever à la connaissance sans crainte de se tromper. Or il en existe deux, l’intuition et la déduction. Par intuition j’entends non le témoignage variable des sens, ni le jugement trompeur de l’imagination naturellement désordonnée, mais la conception d’un esprit attentif, si distincte et si claire qu’il ne lui reste aucun doute sur ce qu’il comprend ; ou, ce qui revient au même, la conception évidente d’un esprit sain et attentif, conception qui naît de la seule lumière de la raison, et est plus sûre parce qu’elle est plus simple que la déduction elle-même, qui cependant, comme je l’ai dit plus haut, ne peut manquer d’être bien faite par l’homme. C’est ainsi que chacun peut voir intuitivement qu’il existe, qu’il pense, qu’un triangle est terminé par trois lignes, ni plus ni moins, qu’un globe n’a qu’une surface, et tant d’autres choses qui sont en plus grand nombre qu’on ne le pense communément, parce qu’on dédaigne de faire attention à des choses si faciles. […] On pourrait peut-être se demander pourquoi à l’intuition nous ajoutons cette autre manière de connaitre par déduction, c’est-à-dire par l’opération, qui d’une chose dont nous avons la connaissance certaine, tire des conséquences qui s’en déduisent nécessairement. Mais nous avons dû admettre ce nouveau mode ; car il est un grand nombre de choses qui, sans être évidentes par elles-mêmes, portent cependant le caractère de la certitude, pourvu qu’elles soient déduites de principes vrais et incontestés par un mouvement continuel et non interrompu de la pensée, avec une intuition distincte de chaque chose ; tout de même que nous savons que le dernier anneau d’une longue chaîne tient au premier, encore que nous ne puissions embrasser d’un coup d’œil les anneaux intermédiaires, pourvu qu’après les avoir parcourus successivement nous nous rappelions que, depuis le premier jusqu’au dernier, tous se tiennent entre eux. Aussi distinguons-nous l’intuition de la déduction, en ce que dans l’une on conçoit une certaine marche ou succession, tandis qu’il n’en est pas ainsi dans l’autre, et en outre que la déduction n’a pas besoin d’une évidence présente comme l’intuition, mais qu’elle emprunte en quelque sorte toute sa certitude de la mémoire ; d’où il suit que l’on peut dire que les premières propositions, dérivées immédiatement des principes, peuvent être, suivant la manière de les considérer, connues tantôt par intuition, tantôt par déduction ; tandis que les principes eux-mêmes ne sont connus que par intuition, et les conséquences éloignées que par déduction. Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, Règle troisième On ne peut pas tout démontrer : Ces choses étant bien entendues, je reviens à l’explication du véritable ordre, qui consiste, comme je disais, à tout définir et à tout prouver. Certainement cette méthode serait belle, mais elle est absolument impossible : car il est évident que les premiers termes qu’on voudrait définir, en supposeraient de précédents pour servir à leur explication, et que de même les premières propositions qu’on voudrait prouver en supposeraient d’autres qui les précédassent ; et ainsi il est clair qu’on n’arriverait jamais aux premières. Aussi, en poussant les recherches de plus en plus, on arrive nécessairement à des mots primitifs qu’on ne peut plus définir, et à des principes si clairs qu’on n’en trouve plus qui le soient davantage pour servir à leur preuve. D’où il paraît que les hommes sont dans une impuissance naturelle et immuable de traiter quelque science que ce soit dans un ordre absolument accompli.
Mais il ne s’ensuit pas de là qu’on doive abandonner toute sorte d’ordre. Car il y en a un, et c’est celui de la géométrie, qui est à la vérité inférieur en ce qu’il est moins convaincant, mais non pas en ce qu’il est moins certain. Il ne définit pas tout et ne prouve pas tout, et c’est en cela qu’il lui cède ; mais il ne suppose que des choses claires et constantes par la lumière naturelle, et c’est pourquoi il est parfaitement véritable, la nature le soutenant au défaut du discours. Cet ordre, le plus parfait entre les hommes, consiste non pas à tout définir ou à tout démontrer, ni aussi à ne rien définir ou à ne rien démontrer, mais à se tenir dans ce milieu de ne point définir les choses claires et entendues de tous les hommes, et de définir toutes les autres ; et de ne point prouver toutes les choses connues des hommes, et de prouver toutes les autres. Contre cet ordre pèchent également ceux qui entreprennent de tout définir et de tout prouver et ceux qui négligent de le faire dans les choses qui ne sont pas évidentes d’elles-mêmes. C’est ce que la géométrie enseigne parfaitement. Elle ne définit aucune de ces choses, espace, temps, mouvement, nombre, égalité, ni les semblables qui sont en grand nombre, parce que ces termes-là désignent si naturellement les choses qu’ils signifient, à ceux qui entendent la langue, que l’éclaircissement qu’on en voudrait faire apporterait plus d’obscurité que d’instruction.
Pascal, De l’esprit géométrique et de l’art de persuader
Vérités de la raison et vérités du cœur : Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur ; c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c’est en vain que le raisonnement qui n’y a point de part essaye de les combattre. Les pyrrhoniens qui n’ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point ; quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison, cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non point l’incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu’il y a espace, temps, mouvement, nombres, est aussi ferme qu’aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. Et c’est sur ces connaissances du cœur et de l’instinct qu’il faut que la raison s’appuie, et qu’elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu’il y a trois dimensions dans l’espace et que les nombres sont infinis ; et la raison démontre ensuite qu’il n’y a point deux nombres carrés dont l’un soit le double de l’autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent ; et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi ridicule et inutile que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes, pour vouloir y consentir, qu’il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu’elle démontre, pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu’à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude, comme s’il n’y avait que la raison capable de nous instruire.
Pascal, Pensées (éd. Brunschvicg), § 282
Ainsi la raison doit reconnaître ses propres limites : 253. – Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison. 267. – La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à reconnaître cela. 270. – Il est donc juste qu’elle se soumette, quand elle juge qu’elle doit se soumettre. 272. – Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. 274. – Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. 277. – Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point ; on le sait en mille choses.
Pascal, Pensées (éd. Brunschvicg)

Le manuel de philosophie
-
La découverte du Nouveau monde, Montaigne, Des Cannibales, Cyrano de Bergerac, l'autre monde, Bougainville, Bouvier, l'usage du monde
- Le 16/01/2018
- Dans Listes EAF , descriptifs candidats libres

Document idéal pour les candidats libres pour la faire la liste bac EAF
-
L'humanisme, Rabelais, Erasme, La Boétie : descriptif idéal pour un candidat libre
- Le 15/01/2018
- Dans Listes EAF , descriptifs candidats libres

Descriptif, l'humanisme


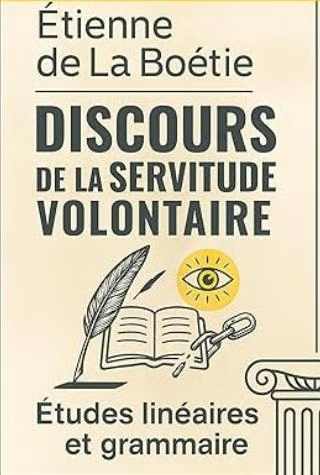
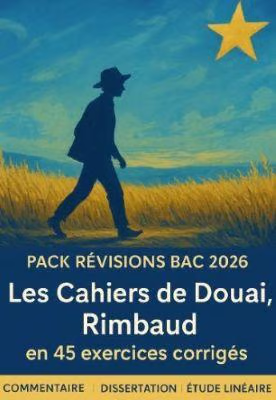
 Littérature d'idées
Littérature d'idées