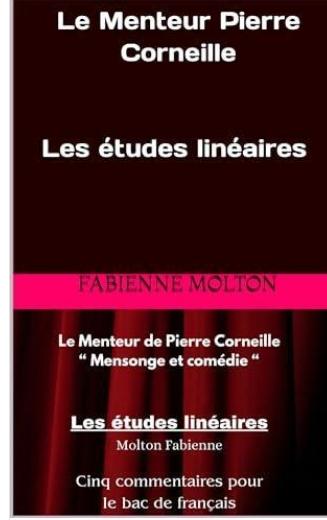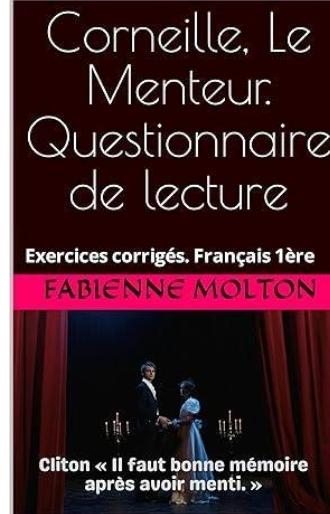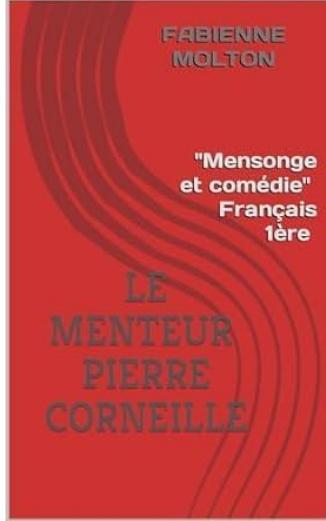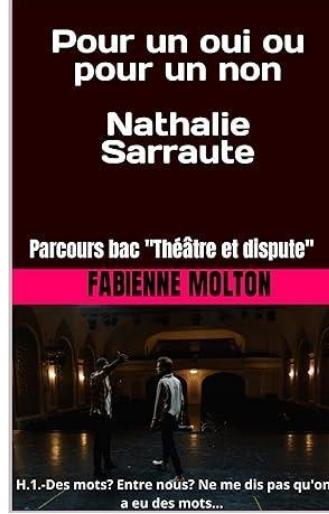Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen-âge à nos jours. Groupement la figure du poète
OBJET D’ÉTUDE : LA POÉSIE
Écriture poétique et quête du sens, du Moyen-âge à nos jours
Groupement : la figure du poète
Texte 1 : Gérard de Nerval, « El Desdichado » (1854).
Texte 2 : Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « Le vieux saltimbanque », (1869).
Texte 3 : Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « L’Étranger » (1869).
Texte 4 : Alfred de Musset, Poésies, « La Nuit de mai », « Le Pélican » (1835).
Texte 5 : Leconte de Lisle, Poèmes barbares, « Les montreurs » (1862).
Texte 6 : Victor Hugo, Les Rayons et les ombres, « Fonction du poète » (1830).
Texte 7 : Théophile Gautier, España, « Le Pin des Landes » (1845).
Texte 8 : Théophile Gautier, España, « Le Poète et la foule » (1845).
Texte 9 : Tristan Corbière, Les Amours jaunes, « Le crapaud » (1873).
-
Gérard de Nerval, « El Desdichado » (1854).
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé, Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie, La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ? Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ; J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron : Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
-
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « Le vieux saltimbanque », (1869).
Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissaitse réjouissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants, pour compenser les mauvais temps de l'année.
En ces jours-là il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail ; il devient pareil aux enfants. Pour les petits c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à vingt-quatre heures. Pour les grands c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelles.
L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent, sans le vouloir, leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai Parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques solennelles.
Elles se faisaient, en vérité, une concurrence formidable : elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues-rouges1 et les Jocrisses2 convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil ; ils lançaient avec l'aplomb des comédiens sûrs de leurs effets, des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans front et sans crâne, comme les orang-outangs, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles.
Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte ; les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupes de leurs mères pour obtenir quelque bâton de sucre, ou montaient sur les épaules de leurs pères pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête.
Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, adossé contre un des poteaux de sa cahute ; une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelles, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.
Partout la joie, le gain, la débauche ; partout la certitude du pain pour les lendemains ; partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici la misère absolue, la misère affublée, pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable ! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas ; il ne chantait aucune chanson, ni gai ni lamentable ; il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite.
Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère ! Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber.
Que faire ? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à me montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté ? En vérité, je n'osais ; et, dût la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ses planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui.
Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchai à analyser ma soudaine douleur, et je me dis : Je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur ; du vieux poëte sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer !
-
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « L’Étranger », (1869).
"Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? - Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. - Tes amis ? - Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. - Ta patrie ? - J'ignore sous quelle latitude elle est située. - La beauté ? - Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. - L'or ? - Je le hais comme vous haïssez Dieu. - Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? - J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages !"
-
Alfred de Musset, Poésies, « La Nuit de mai », « Le Pélican » (1835)
[…]
LA MUSE
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, Ses petits affamés courent sur le rivage En le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, Ils courent à leur père avec des cris de joie En secouant leurs becs sur leurs goitres hideux. Lui, gagnant à pas lent une roche élevée, De son aile pendante abritant sa couvée, Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte; En vain il a des mers fouillé la profondeur; L'océan était vide et la plage déserte; Pour toute nourriture il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, Partageant à ses fils ses entrailles de père, Dans son amour sublime il berce sa douleur; Et, regardant couler sa sanglante mamelle, Sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle, Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, Fatigué de mourir dans un trop long supplice, Il craint que ses enfants ne le laissent vivant; Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, Et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu, Que les oiseaux des mers désertent le rivage, Et que le voyageur attardé sur la plage, Sentant passer la mort se recommande à Dieu.
Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps; Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes Ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérances trompées, De tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, Ce n'est pas un concert à dilater le cœur ; Leurs déclamations sont comme des épées : Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant; Mais il y pend toujours quelques gouttes de sang.
[…]
-
Leconte de Lisle, Poèmes barbares, « Les montreurs » (1862).
Tel qu'un morne animal, meurtri, plein de poussière, La chaîne au cou, hurlant au chaud soleil d'été, Promène qui voudra son cœur ensanglanté Sur ton pavé cynique, ô plèbe carnassière !
Pour mettre un feu stérile en ton œil hébété, Pour mendier ton rire ou ta pitié grossière, Déchire qui voudra la robe de lumière De la pudeur divine et de la volupté.
Dans mon orgueil muet, dans ma tombe sans gloire, Dussé-je m'engloutir pour l'éternité noire, Je ne te vendrai pas mon ivresse et mon mal,
Je ne livrerai pas ma vie à tes huées, Je ne danserai pas sur ton tréteau banal Avec tes histrions et tes prostituées.
-
Victor Hugo, Les Rayons et les ombres, « Fonction du poète » (1830)
|
Le poète en des jours impies Vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, Les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui sur toutes les têtes, En tout temps, pareil aux prophètes, Dans sa main, où tout peut tenir, Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, Comme une torche qu'il secoue, Faire flamboyer l'avenir ! |
C'est lui qui, malgré les épines, L'envie et la dérision, Marche, courbé dans vos ruines, Ramassant la tradition. De la tradition féconde Sort tout ce qui couvre le monde, Tout ce que le ciel peut bénir. Toute idée, humaine ou divine, Qui prend le passé pour racine, A pour feuillage l'avenir.
|
-
Théophile Gautier, España, « Le Pin des Landes » (1845)
On ne voit en passant par les Landes désertes, Vrai Sahara français, poudré de sable blanc, Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eaux vertes D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc ;
Car, pour lui dérober ses larmes de résine, L'homme, avare bourreau de la création, Qui ne vit qu'aux dépens de ce qu'il assassine, Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon !
Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, Le pin verse son baume et sa sève qui bout, Et se tient toujours droit sur le bord de la route, Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.
Le poète est ainsi dans les Landes du monde ; Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde Pour épancher ses vers, divines larmes d'or !
-
Théophile Gautier, España, « Le Poète et la foule » (1845)
La plaine un jour disait à la montagne oisive : " Rien ne vient sur ton front des vents toujours battu ! " Au poète, courbé sur sa lyre pensive, La foule aussi disait : " Rêveur, à quoi sers-tu ? "
La montagne en courroux répondit à la plaine : " C'est moi qui fais germer les moissons sur ton sol ; Du midi dévorant je tempère l'haleine ; J'arrête dans les cieux les nuages au vol !
Je pétris de mes doigts la neige en avalanches ; Dans mon creuset je fonds les cristaux des glaciers,
Et je verse, du bout de mes mamelles blanches, En longs filets d'argent, les fleuves nourriciers.
Le poète, à son tour, répondit à la foule : " Laissez mon pâle front s'appuyer sur ma main. N'ai-je pas de mon flanc, d'où mon âme s'écoule, Fait jaillir une source où boit le genre humain ? "
-
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, « Le crapaud » (1873).
Un chant dans une nuit sans air....
- La lune plaque en métal clair
Les découpures du vent sombre.
....Un chant ; comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif...
- Ça se tait : Viens, c'est là, dans l'ombre...
- Un crapaud !
Pourquoi cette peur
Près de moi, ton soldat fidèle ?
Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue....
- Horreur !
- Il chante.
- Horreur !!
- Horreur pourquoi ?
Vois-tu pas son oeil de lumière....
Non : il s'en va, froid, sous sa pierre.
Bonsoir - ce crapaud-là c'est moi.
Date de dernière mise à jour : 11/11/2018


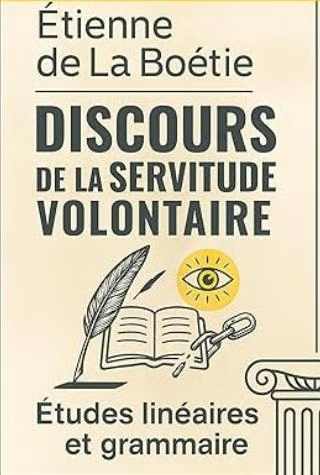
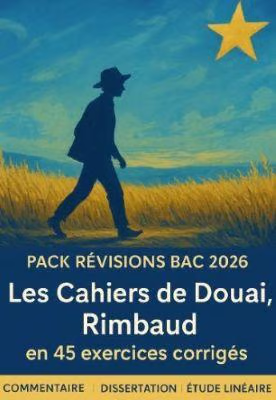
 Littérature d'idées
Littérature d'idées