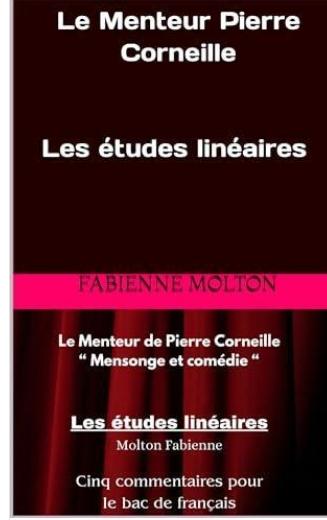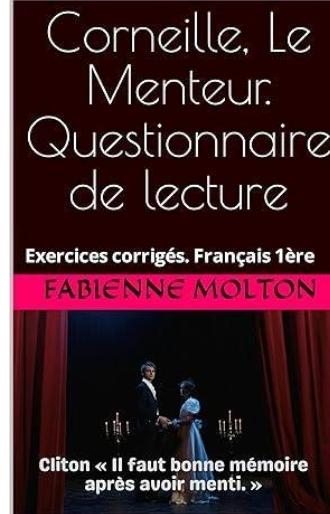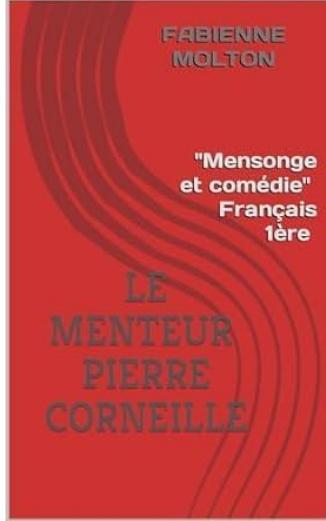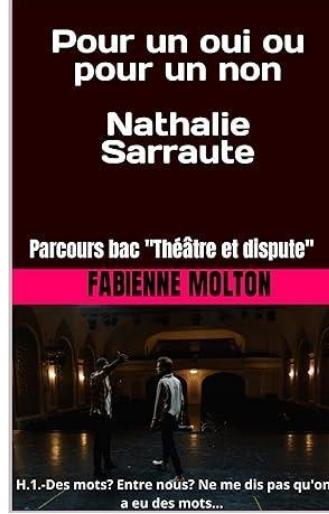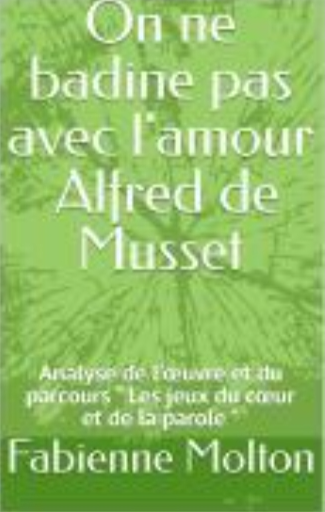La philosophie pascalienne

Dieu sensible au cœur : Document 1
Pascal
Introduction
Le philosophe insiste sur le sentiment de situation de l’homme dans le monde, « l’angoisse », l’homme se sent égaré dans l’univers, il s’effraye lui-même, « je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde », ceci n’est pas l’expression de sa propre subjectivité. Il y a une raison, la disproportion de l’homme, il n’est pas en accord avec ce qu’il y a à connaître. L’homme est un néant à l’égard de l’infini, il vit dans l’angoisse, il est un « milieu entre tout et rien », il est « l’infiniment grand et l’infiniment petit ». Le trop et le trop peu le caractérisent. Nous sommes « englués en terme sartrien dans le monde et nous pouvons à tout instant sombrer dans l’indéterminé. « le peu que nos avons d’être nous cache la vue, l’infini ». Je peux savoir d’une chose qu’elle est sans savoir ce qu’elle est par opposition à Descartes dont nous pouvons saisir l’essence et l’existence. Pour Pascal, il y a une séparation, voire un divorce entre l’essence et l’existence. « Nous connaissons ce qu’il y a d’infini et nous ignorons sa nature ». Les ordres de la réalité dans la philosophie tragique pascalienne ne se rejoignent pas, la réalité est discontinue. Nous sommes à la fois sans repère, égaré, tout s’écoule, tout me fuit ainsi que l’affirme Montaigne. Il met ainsi en avant les contradictions de l’homme qui s’étendent sur plusieurs plans, il est ange et bête, nous avons un mélange de scepticisme et de dogmatisme. Il touche au malheur et au bonheur, à l’être et au paraître. Pascal part d’un senti métaphysique de situation de l’homme dans le monde, c’est l’effroi. Il est nécessaire de communiquer l’angoisse. Pascal est un penseur tragique qui pense la discontinuité de l’être, par opposition à Platon, pour qui la logique dialectique est la continuité et l’ordre. Nous pouvons faire un rapprochement entre pascal et Racine, Andromaque met en scène celui qui aime et qui est désespéré, non aimé de la personne qu’il aime; l’amour au sens de la pensée exclusive est vue par celui qui la reçoit comme quelque chose d’effrayant, chez Racine, la pensée est moralisante. Chez Platon, il y a différents ordres de réalité qui sont incommunicables. Mais pour faire face à ce triste constat, nous avons Dieu, un Dieu sensible au cœur de l’homme. Nous allons voir en quoi consiste cet aspect de la philosophie pascalienne.
Un Dieu sensible au cœur non à la raison
L’espérance qui guide la conversion est avant tout l’attente de cette grâce par laquelle le Dieu parié devient le Dieu sensible au cœur. Dieu se manifeste dans l’histoire par des signes qu’il revient à la liberté de l’homme d’interpréter. Les miracles et les prophéties assurent la perpétuité pour la permanence absolue du dialogue entre l’homme et Dieu. Nous pouvons de christocentrisme, pour se comprendre soi même le monde, les écritures, il faut toujours avoir en la pensée l’incarnation par laquelle la mort passe à la vie, le temps accueille l’éternité et le péché se résout en salut. Mais pour Pascal, il n’y a pas de philosophie chrétienne. Dieu par le directement au cœur à l’intérieur même de l’être, par la grâce, et de l’extérieur par les signes. Mais la grâce et les miracles sont surnaturels, c’est le mystère de Dieu. En le christ, l’homme voit son image, son espérance. Dieu n’est pas caché, il s’est voulu caché. Il y a des révélations intérieures, il se révèle à ceux qui le cherchent, c’est lui-même qui suggère aux hommes, le devoir de le chercher. « Dieu sensible au cœur et non à la raison », la foi est le mouvement de l’homme vers Dieu, un élan d’amour. La grâce oriente l’homme vers le bien. Tous les êtres vivants sont répartis selon trois ordres de grandeur, l’ordre des corps représenté par les rois, les riches et les capitaines, l’ordre des esprits représenté par les avants et celui de la charité qui nous renvoie aux saints et au christ. Les grandeurs charnelles, intellectuelles et spirituelles sont perceptibles chacune à l’intérieur de leur ordre. Le cœur, cette intuition de l’être est aussi un amour de l’être; la raison n’est pas sensible et c’est là, son moindre défaut. L’être moi est l’homme singulier par opposition a l’homme universel, Dieu. Si le moi renie l’amour, l’ordre universel pour son amour à soi, le moi deviens haïssable. L’être est compris entre Dieu et par Dieu. L’amour de soi n’est compréhensible que par rapport à l’amour de Dieu. Un homme qui a conscience de lui-même s’aime lui-même. Le cœur est quelque chose de naturel mais c’est le point d’insertion du surnaturel, c’est dans le cœur que réside tout ce qui constitue la loi. L’homme ne peut se connaître lui-même que par une dérivation de l’être qui se connaît parfaitement par lui-même. Dieu est l’examen de conscience, l’homme ne peut pas connaître son propre être, par opposition au cogito cartésien. En fait nous pouvons affirmer que Dieu est au fond de nous même, c’est pourquoi, Dieu est sensible au cœur et non à la raison.

La raison et le cœur
Les deux ordres de connaissance chez Pascal : Document 2
Critique de la raison et affirmation d'un nouvel ordre de connaissance
Introduction
Nous allons étudier le concept de la raison chez Pascal, sa critique comme connaissance discursive, faculté de l’universel, simple et faculté du fini, les faiblesses de la raison une fois posées, le philosophe affirme la supériorité du cœur au point d’en faire un nouvel ordre de connaissance. Nous verrons en quoi et comment le cœur est associé à Dieu et amène le problème de la prédestination, la chute et le péché originel, car l’homme est disharmonie, il n’a pas d’unité.
La critique de la raison
Le penseur procède à une dénonciation de la faculté de raisonner pour plusieurs raisons. Comme connaissance discursive, elle repose sur le raisonnement, la déduction; c’est un arbitraire de la raison lequel est purement axiomatique. C’est une faculté de l’universel car elle aboutit à des définitions exactes et précises, communicables, c’est une logique inhérente au concept. Elle est simple, elle participe de la pensée, c’est l’intelligence, enfin, c’est la faculté du fini, elle ne peut pas comprendre ce qu’est l’infini sous aucune de ses formes. Ainsi se pose la question de la faiblesse de la raison; elle présuppose dans toutes ses démarches des principes qu’elle n’a pas acquis par le raisonnement. Elle les donne par le cœur ou le sentiment. Les axiomes sont indémontrables, ainsi que les hypothèses sur lesquelles reposent les démonstrations. La raison est plastique, elle est capable de démontrer n’importe quoi; elle est soumise à des forces plus puissantes qu’elle, c’est la passion, l’imagination, il en va de même chez Descartes pour qui cela renvoie à la perception d’une réalité immédiate et les faits qu’elle produise. L’oubli signifie possibilité de perdre les vérités découvertes. La raison n’est pas la faculté dominante chez l’homme. Elle n’est pas ce qui nous fait force à agir. Livrée à elle-même, elle est en proie à des contradictions. Elle dépend de prémisses, de principes indémontrables par opposition au cœur, une raison immédiate. Le cœur a rapport avec l’être. Le cœur donne le « il y a ». C’est un pré savoir sur quoi repose la connaissance. En outre, la faculté de raisonner est faible, elle ne peut réfuter le scepticisme. Il faut fonder la raison sur les connaissances du cœur, les axiomes du cœur.
L’ordre du cœur
L’ordre du cœur, comme la raison est une manière de penser. C’est une connaissance intuitive, immédiate, une sorte de flair, de divination, il procède par induction par opposition à la raison, le cœur à une vérité, alors que la raison à une logique, la contradiction n’est pas un critère de vérité. C’est la faculté de l’individuel, le cœur a des motivations non connues de la raison, une manière de sentir. Ses motivations ne peuvent pas être conceptualisées, le cœur est en fait la faculté de l’insaisissable. Il est complexe, il participe à la fois de l’affectivité car il ne va pas sans émotion, il a de la volonté car il est élan, aspiration, désir, il est un intellect car toute tendance est une direction donc une anticipation et un choix. Le cœur comme sentiment est un instinct, une idée de la vérité. Le cœur est moins la faculté particulière que la centre de nos facultés. Enfin, c’est la faculté de l’infini, il découvre les premiers principes à partir desquels par voie de déduction s’élabore la faculté scientifique. Il aspire à l’illimité et à l’absolu, à l’éternel et au parfait. La raison est la faculté de l’humain, le cœur, la faculté du divin. La raison est partiellement corrompue du fait du péché originel. Si elle eut été absolument corrompue, aucune apologétique n’eut été possible affirme Laporte. Par suite du péché originel, le cœur et la raison sont frappés d’impuissance et d’erreur. La raison est incapable d’expliquer les contradictions et les formes de l’infini. Les erreurs de la raison sont toutes soumises aux puissances trompeuses comme l’imagination. Il nous faut mettre en avant l’impuissance du cœur à communiquer ses certitudes si intimes, il y a erreur du cœur lorsqu’il est dominé par la concupiscence, il confond alors l’absolu du vrai et du Bien, il fait de Dieu, des idoles de simples apparences de ces valeurs. C’est le problème de la prédestination, la chute ou le péché originel, l’homme en effet est perçu comme disharmonie car il n’a pas d’unité. Ainsi la raison ne peut nous éclairer sur la nature de Dieu. Elle ne peut pas même nous assurer de l’existence de Dieu. La raison manifeste la grandeur de l’homme et elle est éclairée par le cœur. Concernant le mystère et l’existence de Dieu, il y a des cas où nous évitons l’absurde qu’à la condition d’admettre l’inexplicable. Il y a une logique du cœur, une rationalité, il est la partie intuitive de la raison.

Le Dieu de Pascal
Le concept de pari : Document 3
Les pensées de Pascal
Introduction
Nous pouvons poser la félicité de l’homme avec Dieu. Mais l’homme toujours en proie aux diverses contradictions chercher à échapper à sa condition mortelle par le divertissement, l’imagination est un autre moyen de fuir sa condition humaine. Le divertissement est un aspect de la nature humaine qui ne cesse de fasciner Pascal, avec les divertissements, nous pouvons mettre en avant la facilité avec laquelle l’homme efface la souffrance et le mal de sa condition. Pour se rendre heureux, l’homme s’avise de n’y pas penser. Nous entendons par divertissement, les jeux et la pensée religieuse qui voudraient apaiser l’homme et l’installer en toute quiétude en ce monde, en lui faisant rechercher la perfection, contre la pensée jésuite. Il ne doit pas être dans le souci des serviteurs de Dieu de participer à l’assoupissement, l’apaisement du mal en l’homme. Il faut être pauvre en divertissement pour vivre l’absence de Dieu comme absence. Le second moyen pour échapper à notre condition est l’imagination. Elle est complice de l’amour propre, elle fait déjà office de divertissement, de refuge car elle permet de composer un personnage idéal. Il en va de même pour le divertissement, tout ce qui empêche l’homme de penser lui-même entre dans la catégorie des divertissements au sens pascalien du terme. Car penser à soi, c’est regarder le tragique de sa propre condition. Tout divertissement est une illusion, c’est-à-dire, relève de l’imagination. On croit oublier dans le moment la réalité. A ce point de la réflexion, nous arrivons à la section III des « Pensées », le pari et la liberté, nous intitulerons notre étude, le dieu parié.
Le dieu parié
La théologie de conversion inclut le risque vécu par lequel j’entre en relation avec ma situation d’être jeté au monde par l’acte d’amour qui m’a créé libre; le visage du hasard est celui du risque que je n’ai même pas choisi. Je m’appréhende immédiatement comme un être risqué, la représentation est dramatique. Dans ce déjà là, je m’appréhende comme un être risqué. Dans le concept du pari, je rejoins mon essence d’être risqué, je mets en œuvre ce qui me fonde, ma liberté. Le chemin spirituel culmine, dans son visage pathétique, lorsque le moi se fond avec le risque qui le mit au monde et à partir duquel un retour amoureux vers le père est possible. Je réponds librement à mon essence d’être risqué dans la conversion. Le pari n’est pas un argument apologétique, il est plutôt la transcription logique d’une expérience spirituelle essentielle. C’est en collant à son essence d’être risqué que l’homme répond à la plénitude en répondant à l’appel lancé par « je ». « Quitte tout et suis moi ». Il faut renoncer aux divertissements. Toute la dialectique pascalienne nous tourne vers le monde qui est un rien qui s’anéantit face à l’éternel, l’éternité. Le parallélisme de l’horizon psychologique et mystique auquel Pascal et Dostoïevski sont sensibles nous conduit à l’expérience du jeu. Dans l’expérience spirituelle, il y a une mise qui se définit ainsi, c’est un bien possédé dont on peut jouir, que l’on expose à l’anéantissement, afin de trouver plus qui n’était lui-même. Dans l’acte de miser, il y a une dépossession acceptée, afin qu’il y ait une multiplication de ce bien risqué. Ce qui est misé, c’est soi même dans son attachement aux biens de ce monde. Si ce moi mondain s’expose ainsi à son propre anéantissement, c’est qu’il espère resurgir, sublimé, ressuscité, baignant enfin dans la lumière de la certitude. Pascal utilise le vocabulaire et les concepts du jeu pour décrire le moment pathétique de l’itinéraire spirituel, celui du renoncement et de la mort à soi même le pari, c’est la conversion elle-même, vécu à l’intérieur de l’ordre de la raison. Ce qui est misé, c’est l’ensemble des divertissements grâce auxquels ma vie est déchue de la présence divine qui se continue en possible. Miser c’est vivre l’anéantissement de ce que l’on possédait, c’est le pari existentiel. Le renoncement au monde n’est peut être pas en lui-même un idéal dans lequel s’installe le parfait chrétien, il est un effort qui veut équilibrer la tentation immédiate et incessante, celle qui pousse la conscience à se fondre avec la terre, la concupiscence, autant celle-ci est spontanée, autant le renoncement exige la volonté. C’est dans cet entre deux que le chrétien vit l’imitation de Jésus Christ. Il y a correspondance entre le vécu humain et la parole chrétienne. La conversion est l’acte libre, je me fais violence a moi-même. Se convertir, c’est vouloir ne pas oublier, c’est avoir conscience dans la chute de l’oubli. Ne pas oublier son état relève de la puissance de l’homme, si l’on glorifie sa pauvreté, c’est qu’on en a fait son orgueil. Ainsi, la dialectique de Pascal ne se veut pas démonstrative de l’existence de Dieu, elle veut montrer que les forces rationnelles ne peuvent conclure, le témoignage de l’athée qui proclame que Dieu n’existe pas est la preuve de la justesse de la parole chrétienne. C’était une perversion de celle-ci que de prétendre pouvoir accéder à Dieu par son propre effort rationnel. C’était le ramener au rang d’idéologie; là où le témoignage athée devient absurde et extravagant, c’est lorsqu’il se glorifie du néant. Une telle attitude est faible sur le plan rationnel, car elle se contredit. L’homme qui découvre sa faiblesse ne peut plus conclure valablement sur l’existence ou l’inexistence de Dieu. Son attitude est extravagante sur le plan psychologique car comment peut on se réjouir de sa mort absolue, et de son moi anéanti. Donc la première et intuitive relation de l’homme au monde est marquée par le néant, un désir de dépassement de ce néant. c’est à la fois l’absence et le désir de la présence de Dieu qui fondent notre présence au monde. Don Juan devient pour Pascal non pas celui qui vit Dieu, mais celui qui le manifeste.
Date de dernière mise à jour : 16/05/2019

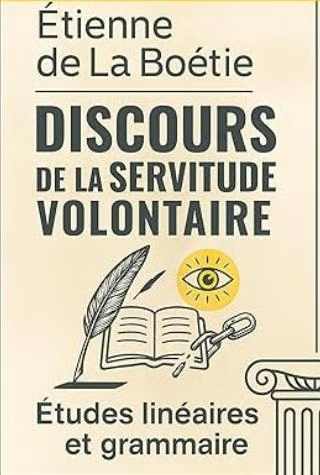
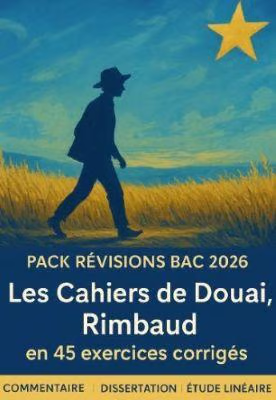
 Littérature d'idées
Littérature d'idées 




 ème visiteur
ème visiteur