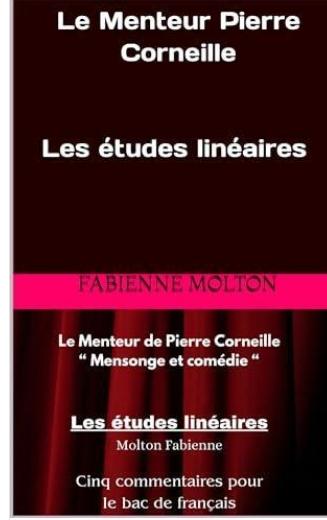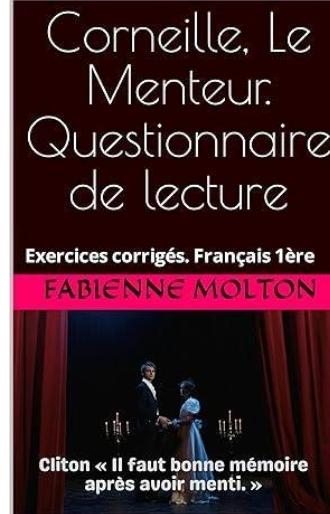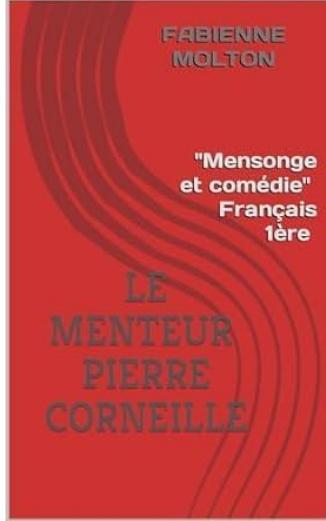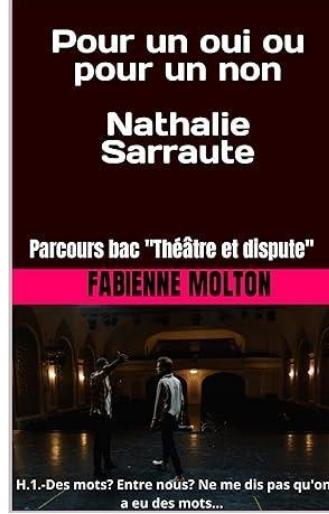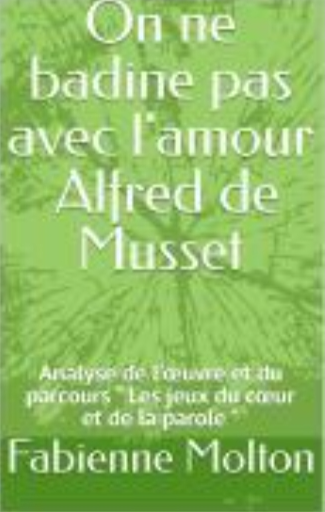Zola, l'argent, ch. 8 le portrait de Saccard
Comment Zola dresse t'-il le portrait de Saccard triomphant tout en dénonçant sa cupidité?

Séquence le roman : Zola, l'argent, le portrait de Saccard
Chapitre 8 : un personnage triomphant : condamnation de la cupidité, un roman naturaliste
La nature du roman
"La nature du roman, si elle était connue, les romans seraient écrits par des fonctionnaires. Les thèmes des romans seraient enregistrés sur logiciel, les romans composés par ordinateur. La nature du roman est inconnue. Elle fuit sous l'esprit de celui qui écrit le roman comme la femme fuit, tout en s'abandonnant aux mains de son amant, tandis que sa propre imagination divague. La nature du roman est l'absence. Le roman n'est pas seulement mobile, il est mouvant, il se transforme en même temps qu'il se déroule, il ignore à jamais le prochain mot. La nature du roman est l'infini. Le roman est l'autobiographie en acte. Le romancier est une création de chaque instant. Il dit « Je » pour mentir. Il s'affirme homme et femme, ange et monstre, jeune homme et vieillard. Il meurt autant de fois qu'il faut. Il aime infatigablement. La nature du roman est le sexe. Le roman est un acte sexuel. La nature du roman est une femme rousse, dans une salle obscure, qui convoite un acteur de cinéma. « Tout à l'heure, chez moi, Lexington Avenue. » Elle ferme les yeux et s'enfonce les ongles dans les paumes. La nature du roman est un vieil homme, assis sur un pliant, la nuque protégée du soleil par un mouchoir, qui regarde, immobile, le paysage poussiéreux. Il boit une orchiatta, que lui apporte un jeune garçon de café, en qui il croit vaguement se reconnaître, et tirant de sa poche un carnet, il tente de noter un souvenir qui vient de lui traverser l'esprit. Sa main tremble. La nature du roman est la guerre entre le désir et la mémoire, entre l'écriture et le temps. La nature du roman est l'impossible."
Pierre Bourgeade, La nature du roman
"La nature du roman, si elle était connue, les romans seraient écrits par des fonctionnaires. Les thèmes des romans seraient enregistrés sur logiciel, les romans composés par ordinateur. La nature du roman est inconnue. Elle fuit sous l'esprit de celui qui écrit le roman comme la femme fuit, tout en s'abandonnant aux mains de son amant, tandis que sa propre imagination divague. La nature du roman est l'absence. Le roman n'est pas seulement mobile, il est mouvant, il se transforme en même temps qu'il se déroule, il ignore à jamais le prochain mot. La nature du roman est l'infini. Le roman est l'autobiographie en acte. Le romancier est une création de chaque instant. Il dit « Je » pour mentir. Il s'affirme homme et femme, ange et monstre, jeune homme et vieillard. Il meurt autant de fois qu'il faut. Il aime infatigablement. La nature du roman est le sexe. Le roman est un acte sexuel. La nature du roman est une femme rousse, dans une salle obscure, qui convoite un acteur de cinéma. « Tout à l'heure, chez moi, Lexington Avenue. » Elle ferme les yeux et s'enfonce les ongles dans les paumes. La nature du roman est un vieil homme, assis sur un pliant, la nuque protégée du soleil par un mouchoir, qui regarde, immobile, le paysage poussiéreux. Il boit une orchiatta, que lui apporte un jeune garçon de café, en qui il croit vaguement se reconnaître, et tirant de sa poche un carnet, il tente de noter un souvenir qui vient de lui traverser l'esprit. Sa main tremble. La nature du roman est la guerre entre le désir et la mémoire, entre l'écriture et le temps. La nature du roman est l'impossible."
Pierre Bourgeade, La nature du roman
Quelques définitions :
Roman : long texte en prose la plupart du temps imagé où l'auteur cherche à éveiller l'intérêt par la peinture des moeurs, l'analyse des caractères et la singularité des aventures.
Le héros
Le héros tragique :
Il est exemplaire mais il doit affronter un destin où tout est perdu d'avance. Il est à la fois coupable et innocent alors la seule solution qui lui reste pour faire disparaitre ses malheurs est la mort.
Le héros problématique
Le héros de roman : Le sens de sa vie a perdu son côté transparent. Il n'a pas de destin. Il n'a pas non plus de modèles de destin. Il ne sait pas pourquoi il vit et ne connait aucunement ses valeurs. Son moi est changeant et son être instable.
Anti héros :
Personnage de fiction n'ayant pas les caractéristiques habituelles du héros
Naturalisme :
Mouvement littéraire qu prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail de documentation et de méthode du psychologiste.
Le héros
Le héros tragique :
Il est exemplaire mais il doit affronter un destin où tout est perdu d'avance. Il est à la fois coupable et innocent alors la seule solution qui lui reste pour faire disparaitre ses malheurs est la mort.
Le héros problématique
Le héros de roman : Le sens de sa vie a perdu son côté transparent. Il n'a pas de destin. Il n'a pas non plus de modèles de destin. Il ne sait pas pourquoi il vit et ne connait aucunement ses valeurs. Son moi est changeant et son être instable.
Anti héros :
Personnage de fiction n'ayant pas les caractéristiques habituelles du héros
Naturalisme :
Mouvement littéraire qu prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail de documentation et de méthode du psychologiste.
*** Commentaire
Emile Zola – L’Argent, portrait de Saccard, chapitre 8
Texte :
Alors, il sembla, au milieu de cette gloire, que l'astre de Saccard, lui aussi, montât encore à son éclat le plus grand. Enfin, comme il s'y efforçait depuis tant d'années, il la possédait donc, la fortune, en esclave, ainsi qu'une chose à soi, dont on dispose, qu'on tient sous clef, vivante, matérielle ! Tant de fois le mensonge avait habité ses caisses, tant de millions y avaient coulé, fuyant par toutes sortes de trous inconnus ! Non, ce n'était plus la richesse menteuse de façade, c'était la vraie royauté de l'or, solide, trônant sur des sacs pleins ; et, cette royauté, il ne l'exerçait pas comme un Gundermann, après l'épargne d'une lignée de banquiers, il se flattait orgueilleusement de l'avoir conquise par lui-même, en capitaine d'aventure qui emporte un royaume d'un coup de main. Souvent, à l'époque de ses trafics sur les terrains du quartier de l'Europe, il était monté très haut ; mais jamais il n'avait senti Paris vaincu si humble à ses pieds. Et il se rappelait le jour où, déjeunant chez Champeaux, doutant de son étoile, ruiné une fois de plus, il jetait sur la Bourse des regards affamés, pris de la fièvre de tout recommencer pour tout reconquérir, dans une rage de revanche. Aussi, cette heure qu'il redevenait le maître, quelle fringale de jouissances ! D'abord, dès qu'il se crut tout-puissant, il congédia Huret, il chargea Jantrou de lancer contre Rougon un article où le ministre, au nom des catholiques, se trouvait nettement accusé de jouer double jeu dans la question romaine. C'était la déclaration de guerre définitive entre les deux frères.
Problématique :
Comment Zola dresse-t-il le portrait de Saccard, triomphant tout en dénonçant sa cupidité ?
Plan :
Toute d’abord, nous verrons la description de Saccard triomphant puis nous étudierons la condamnation de la cupidité enfin nous montrerons que ce portrait est une description naturaliste.
I. Saccard triomphant.
1. La description est structurée, la première phrase en point de vue omniscient présente l’objet décrit : Saccard a réussi avec la banque universelle d’où la métaphore « astre de Saccard »qui suggère son ascension sociale. Le CC de temps « au milieu de cette gloire » avec le déterminant démonstratif renvoie à la description de la gloire de Napoléon III à l’exposition universelle, le narrateur omniscient émet un doute sur le triomphe de Saccard en utilisant le modalisateur, « il sembla que » suivi du subjonctif imparfait « montât ».
- (l.2-9) Un discours indirect libre retranscrit à la 3ème personne et au passé les paroles de Saccard.
- (l.9-11) La phrase est au point de vue interne et livre au lecteur un souvenir de Saccard avec le verbe « il se rappelait » : c’est un retour en arrière sur l’incipit.
- (l.11-12) L’exclamation est un discours indirect libre.
- (l.12-15) Le narrateur commente la description de Saccard en point de vue omniscient. Il utilise le modalisateur « se crût ».
2. La description est organisée autour du champ lexical de la fortune et du pouvoir – « La fortune » (l.2) >> pouvoir tyrannique (l.4 ; 5 ; 6 ; 10). Cela abouti à la personnification récurrente du Roman « Paris vaincu si humble à ses pieds » Saccard est cupide et dominateur.
3. Le discours indirect libre fait entendre de façon directe l’habilité du personnage (l.3).
« On » correspond à Saccard seul qui voit dans la fortune un instrument de domination « Il congédia Huret, il chargea Jeantrou ».
Transition :
La description de Saccard est rendue plus vivante par l’usage du discours indirect libre et par l’encadrement de la description par des phrases en point de vue omniscient où l’auteur dénonce la cupidité.
II. Condamnation de la cupidité.
1. Le narrateur omniscient dénonce que le triomphe de Saccard n’est qu’illusion « il sembla » >> apparence ; « il se crut » suggère que Saccard s’illusionne sur ses propres capacités.
2. En outre, Zola utilise différentes remarques pour dénoncer les défauts de Saccard. Pour se faire, il utilise l’implicite et la connotation des mots (l.2) la personnification de la fortune en esclave. Le champ lexical de la faim et des instincts montrent qu’il ne domine ses désirs (l.11) « fringale » > la faim.
Saccard se dit maître de sa fortune mais pas de ses désirs.
Transition :
Zola rédige implicitement un réquisitoire contre la cupidité dans le XIXème siècle.
III. Un texte naturaliste.
1. A travers, le mélange des points de vue, Zola livre une étude de la psychologie humaine, il démontre la force de l’instinct de domination chez les hommes, Zola empreinte cette théorie au Darwinisme (Théorie biologique selon laquelle l’homme est un animal qui a évolué au fil des siècles ; c’est la loi de la solution naturel).
Cela est visible (l.9) « Paris vaincu ». En outre (l.6-7), le pléonasme « il se flattait orgueilleusement » montre à quel point l’Homme peut s’attribuer des qualités qu’il ne possède pas (vanité) pour justifier sa légitimité à dominer les autres. C’est bien une description naturaliste puisque Zola s’inspire des théories biologiques.
2. (l.12-15) L’intervention du narrateur omniscient relie l’opposition entre les frères Rougon-Macquard à l’histoire de la question romaine (Napoléon III s’allie avec le Vatican car il est catholique mais aussi avec les Italiens qui sont contre les Autrichiens ce qui l’handicape car les italiens sont contre le Vatican)
Zola allie Histoire et histoire d’où « C’était la déclaration de guerre » >> anticipation entre la France et la Prusse qui mettra fin au 2nd Empire. Saccard est donc un financier à la gloire illusoire car Napoléon III est un empereur au règne fantoche. Cette description est naturaliste car Zola utilise un moyen pédagogique >> personnage romanesque pour expliquer la société de son temps, il fait de la littérature une science humaine.
Conclusion :
Cette description mêle une description de Saccard à une condamnation de la cupidité et un réquisitoire contre Napoléon III pour fournir aux lecteurs une étude sociologique, historique, psychologique du 2nd Empire.
Ouverture :
En ce sens la description de Saccard fait écho à son exposition universelle.
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019
Les commentaires sont clôturés

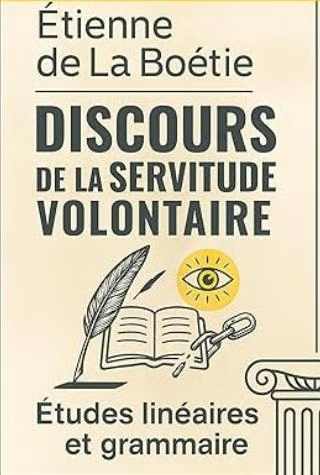
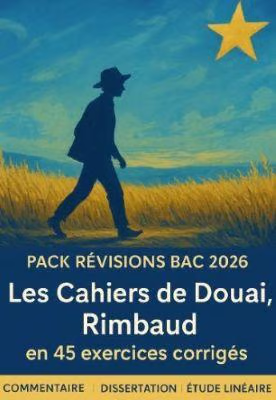
 Littérature d'idées
Littérature d'idées