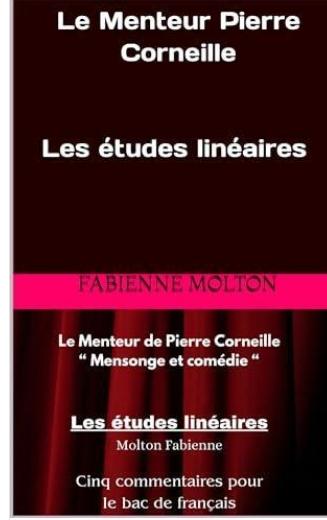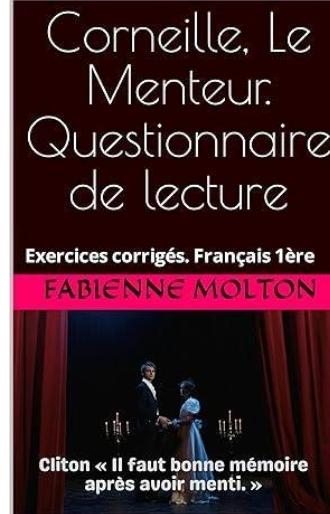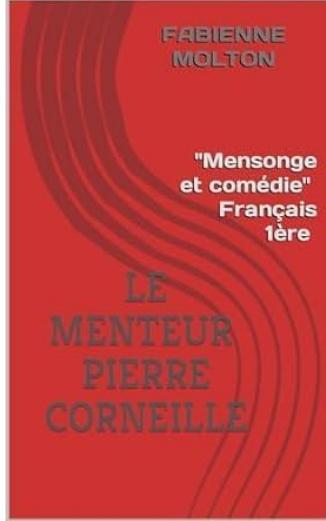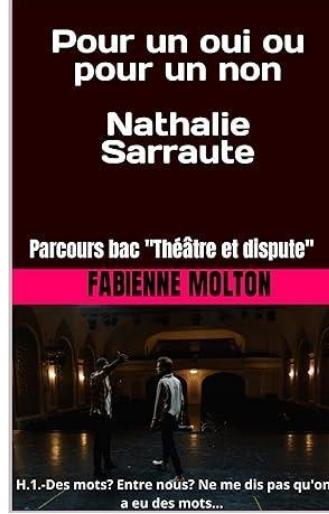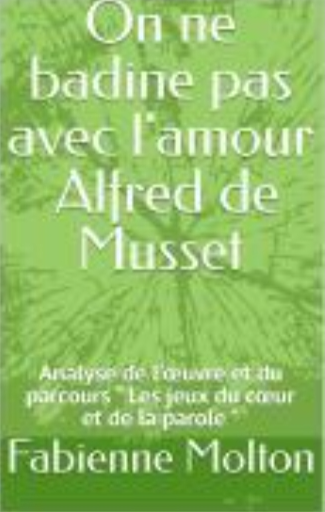Oral, Jaccottet, Paysages avec figures absentes

Jaccottet
Oral EAF : bac
Lecture du texte
- Philippe Jaccottet, Paysages avec figures absentes, 1976 : Travaux au lieu dit l'étang, extrait
- Là où depuis des années autant que je me souvienne...
- Ce matin l'eau voile l'herbe
- L'Ecume revient aux roseaux
- Plume par le vent poussée!
Texte jaccottet 1 (1.35 Mo)
Biographie pour l'oral, Philippe Jaccottet
Questionnaire sur la vie de Jaccottet
1 -
Quand Jaccottet est-il né?
Il est né en 1925
2 -
Où s’installe t’-il avec sa famille en 1933?
Philippe Jaccottet s'installe, avec sa famille, à Lausanne en 1933.
3 -
Qui fait connaître à Jaccottet le romantisme allemand et les poètes, Novalis, Holderlin?
Gustave Roud
4 -
Qui lui fait découvrir la beauté de la nature et des paysages ?
Gustave Roud
5 -
Dès sa jeunesse, est-il marqué par l’écriture?
Oui
6 -
Qu’a t’-il fait comme études?
Des études de lettres à Lausanne
7 -
Quels sont ses premiers écrits?
pièce de théâtre, Perceval
C'est en mai 1945 qu'est publié son premier ouvrage, Trois poèmes aux démons
il écrit une seconde pièce, La Lèpre
8 -
Obtient-il sa licence de lettres?
Oui en Juillet 1946
9 -
Veut-il enseigner?
Non
10 -
Quelle est sa passion?
Les traductions
il se lie d'amitié avec le poète italien Giuseppe Ungaretti, dont il commence à publier des traductions en 1948 dans Pour l'Art.
Il est ensuite engagé par l'éditeur Henry-Louis Mermod, il travaille sur des traductions
11 -
Quelle rencontre importante fait-il ?
Il rencontre Ponge, Yves Bonnefoy
12 -
De quand date la publication de son premier recueil?
la rédaction de son premier recueil, L'Effraie, 1947
Questionnaire sur son œuvre
1 -
De quelle nature sont ses poésies?
En vers et en prose
2 -
Quel rapport traduisent-elles?
Un rapport à la nature et au monde
3 -
Quels autres genres littéraires que la poésie Jaccottet a t’-il travaillé?
Les Essais, les carnets de notes
4 -
Comment qualifieriez-vous l’écriture Jaccotéenne?
« une esthétique de la mesure et du non-dit »
5 -
Quelle fonction confère t-il au poète?
Le poète doit donc « veiller comme un berger [et] appeler / tout ce qui risque de se perdre s'il s'endort »; son « travail est de maintien, de conservation d'une mémoire
6 -
Quelle idée récurrente est-elle présente dans son ouvrage?
La lumière. Ses écrits doivent être un chemin de clarté pour le lecteur.
7 -
Cela a t’-il influencé sa forme d’écriture?
Oui car Jaccottet considérait qu’il existe « un conflit entre la rime et la vérité ».
Introduction :
1 -
Qui est Jaccottet?
Jaccottet est un poète français contemporain (en vie) : un des deux poètes les plus importants avec Yves Bonnefoy :
2 -
Qui sont ces deux poètes?
ce sont deux poètes de la même génération qui dans les années 70 ont développé un travail important dont on peut donner les éléments caractéristiques :
-poètes qui ne sont pas révolutionnaires au niveau de la forme
- poésie de la renaissance : Ronsard, du Bellay
- poésie baroque : Voiture, de Viau
- poésie classique : Boileau
==> poésie marquée pas des conventions formelles strictes : poésie est considérée comme un artisanat
- première révolution : 1800-1830 (Allemagne) --> Hölderlin Schiller / 1810-1830 (France)
-poésie romantique : Hugo, Musset, Lamartine
- poésie symboliste : Baudelaire, Mallarmé (allégories rapport entre idées et évènements)
- poésie parnasse : Heredia (l'art pour l’art)
==> libération relative des contraintes formelles
-trimètres
-formes amples
- poésie considérée comme vision d'une mystique sans Dieu, le poète doit se faire voyant, la poésie devient un lieu d'exploration du mystère de la nature.
-complication de l'Alexandrin
- seconde révolution : 1870
- modernisme ( Mallarmé, Apollinaire)
- surréalisme ( breton, Eluard)
==> libération complète de la force
-recours au vers libre
-poésie en prose (gaspard de la nuit de Bertrand 1846 , petits poèmes en prose de Baudelaire 1867)
-écriture automatique (Desnos)
3 -
En quel sens Jaccottet retravaille t’-il l’écriture poétique?
Jaccottet retravaille l'Alexandrin et utilise des vers libre et des poèmes en prose sous toutes les formes.
4 -
De quelle nature la poésie du recueil est-elle?
Ce recueil est essentiellement composé de prose poétique et prose critique ( prose dans laquelle il va expliquer ce que doit être la poésie et comment elle doit fonctionner)
5 -
Que pouvez-vous dire sur le titre?
Paysage avec figures absentes :
-titre de tableau de Nicolas poussin
- tension dans le titre avec//absente
- les figures existent en creux et se font remarquer par leur absence . Les dieux se sont remarquer par leur absence.
- jadis les Grecs chantaient les dieux, nous sommes dans un monde ou personne ne croit en Dieu
6 -
Quelle question faut-il alors se poser à la lecture de Jaccottet?
qu'est ce que le poète peut faire dans ce monde sans dieux ?
= redonner les traces, fragments de sens, la lumière qui sont comme la présence absente, le souvenir des dieux.
7 -
Quel sens peut-on donner à ce poème en prose?
Il relève de la prose critique, il s'agit d'une méditation en prose dans laquelle le poète réfléchit sur ce qu'est la poésie, sur ce qu'elle doit être et sur la manière dont il faut la composer. Ça relève en quelque sorte de l'art poétique ( consiste à écrire un poème qui dit ce que doit être le poème) tout se passe comme si Jaccottet nous ouvrait la fabrique de son poème On peut ainsi avoir le fonctionnement de l'écriture par essais et erreurs. Il n’y a donc pas que les vers définitifs mais la révélation de tout un travail de construction dans l’écriture poétique.

Plan possible pour un commentaire :
- I- un texte poétique ? (Partie qui définit la poésie on peut la réutiliser)
- A- rythmes
- B- le jeu des signifiants (jeu de mots)
- C- images et symboles
- II- poétique de la prose critique
- A- la nature comme atelier
- B- la pluralité des genres
- C- la prolifération des références culturelles
- III- une éthique de l'Ouvert
- A- le dédoublement inquiet
- B- la dialectique de l'image
- C- la condition du rapport au monde
- Signifiant (représentant ) : frange
- Signifié (représenté) : romanité
- ( Roland Barthes)
Problématique possible :
En quoi ce texte poétique, d’une prose critique est-il révélateur d’une éthique de notre condition au monde?
Questionnaire sur le passage en fonction des axes d’étude :
I-
un texte poétique ? (Partie qui définit la poésie on peut la réutiliser)
A-
rythmes
1 -
Est-ce un texte en prose? Montrez en quoi
C'est un texte en prose donc on peut se poser la question si c'est un poème ou non.
Un texte en prose :
- on peut définir la prose comme l’absence d'enjambements.
- les paragraphes
- la longueur des phrases
- vers en italique par contraste : c'est de la prose, cela donne un aspect critique à la prose
2 -
Peut-on parler de prose poétique? Pourquoi?
On peut dire que c'est de la prose poétique pour plusieurs raisons :
-car Jaccottet a été influencé par des proses poétiques et critiques de Francis Ponge dans "la rage de l'expression" il explique comment il construit ses poèmes dans des textes critiques mais qui ont aussi une ambition poétique.
Ici on est dans un genre qui existe encore.
-les rythmes sont très travaillés, les phrases sont musicales il y a un travail sur les rythmes ( les rimes). Il repose sur des phrases amples et qui se referment brutalement. C'est accentué par la conclusion du paragraphe
3 -
Peut-on dire que les rythmes soient travaillés?
==> les rythmes sont travaillés :
- ce sont des rythmes mimétiques ( imite les rythmes de la nature)
- ce sont des rythmes théorétiques (théorie : contemplation) qui miment les mouvements de la pensée, de la méditation qui va et qui vient ("je pense", "je devine"..)
--> on a une prose qui travaille au niveau de l'incise. On a des phrases qui reposent en permanence sur le jeu des virgules,...
I-
un texte poétique ? (Partie qui définit la poésie on peut la réutiliser)
B-
le jeu des signifiants (jeu de mots)
1 -
A quelles conditions un texte est-il poétique?
S’il prend en compte les signifiés et joue avec les signifiants. Ex, Ponge écrivait des poèmes en prose poétique, il jouait beaucoup avec les signifiants.
2 -
Relevez une figure de style sur le signifiant
-syllepse "plume" --> plume de l'oiseau et plume de l'écrivain
Il lit le Paysage comme s’il l’écrivait
"Une inscription fugitive"
"Lecture"
"Page de la terre"
3 -
Comment le réel est-il perçu par le lecteur?
-->Le poète déchiffre un réel déjà écrit, il maitrise cela car le réel n'est pas fait de choses mais d’ éléments de poésie alors le maître est le poète
-antanaclase
-allitération l.24, 27-28 en m, poème en l
-assonances l24 (il y en a partout ça rythme le texte), l21-24 en i
I-
un texte poétique ? (Partie qui définit la poésie on peut la réutiliser)
C-
images et symboles
1 -
Ce texte a t’-il beaucoup d’images?
Il y a une image de la mémoire de l’eau
- permet d'identifier le signifiant (étang) et le signifié du lieu
- toute la rêverie part du principe qu'il y avait de l'eau et qu'il y en a de nouveau
- que le vent ride (paronomase de ride, rive)
-barrière de roseaux
- cette ligne blanche
- ces images font comme si le paysage était (idée de la ligne) animé, humain
- inscription fugitive sur la page de la terre --> métaphore filée du paysage comme inscription
-le paysage est un livre
2 -
Montrez que le réel est perçu comme un ensemble de signes énigmatiques
- La nature semble prête à livrer un secret
-une lecture, une recherche
- image
- l'étang est un miroir que l'on aurait tiré au petit jour des armoires de l'herbe
- l'herbe est une armoire
- l'étang est un miroir
- l'étang est le miroir de l'armoire
- l'écume est la lingerie tombée au pied d'une femme qui vient de se dénuder.
3 -
Expliquez la métaphore filée de la chambre et montrez que le poète tente de rendre compte du secret du paysage.
-idylle : histoire d'amour, genre littéraire qui raconte des histoires d'amour et par métonymie on dit que l'histoire d'amour elle même est une idylle
-toute eau nous parle : personnification
- parle avec insistance : il y a une dimension performative de cette expression
- une grâce : personnifie l'eau
-son mélange illégitime à la terre : l'eau ne devrait pas se mélanger : idée d'illégitimité ( qui ne devrait pas être la pour des raisons morales ). Ce mélange des éléments est une sorte d'adultère, une union monstrueuse de l'eau et la terre
- son secret : secret du signe des mots : il essaye de découvrir dans le secret les mots la bonne manière de rendre compte du secret du paysage
II-
poétique de la prose critique
A-
la nature comme atelier
1 -
Quel est le champ lexical de la nature?
Poétique : règle de composition d'un genre littéraire
Tous les champs lexicaux de la nature : arbres, et les quatre éléments : - -- l'eau
- la terre
- le feu
- l'air
le mot nature lui même apparaît
La nature est l'atelier du poème qui est en contact avec la nature
II-
poétique de la prose critique
B-
la pluralité des genres
1 -
Quels sont les différents types de genres utilisés par Jaccottet?
Utilisation de différents types de genres :
- vers s
-prose poétique ( décrit la nature de manière poétique )
-prose critique ( prose qui décrit l'activité de faire de la poésie de manier la poétique)
2 - Montrez que la prose poétique devient peu à peu une prose critique qui devient à son tour un poème
Toute l'isotopie de la nature montre l'introduction entre la prose poétique et la prose critique.
Et le 3ème paragraphe est brutal avec le "je"
Isotopie de la poésie
"idylle", "poème", "poésie", « madrigal", "plume", "image", "signe", "secret"
--> le poème esquisse le mouvement suivant :
prose poétique qui peu à peu devient une prose critique et qui devient enfin un poème
II-
poétique de la prose critique
C-
la prolifération des références culturelles
1 -
Relevez et analysez le paradoxe du texte.
- on a l'impression d'une méditation bucolique : "d'une simple rêverie de poète rustique" . En fait, c’est un texte aux références culturelles riches. C’est un texte cultivé et nourri de culture.
Il y a aussi des références cachées : méditation sur les images qui proviennent de l'étang :
-poème qui parle d'une conception orphique de la poésie : champ lexical du lyrisme et celui de la mort - le poète est celui qui va chanter parmi les morts (ombres : métonymie pour les morts) or au moment de cette définition lyrique de la poésie par Orphée, il y a les premiers tercets qui parlent d'un reflet dans les temps qui peuvent devenir flou = le savoir de l’image.
2 -
Avons-nous une allusion aux figures mythologiques?
"narcisse" et la conception de la métamorphose de l'eau. De l'idylle, de la chambre,... , nous pouvons dire que les figures mythologiques sont là mais elles sont absentes. On est avec leur absence.
c'est un endroit du réel ordonné , harmonieux c'est-à-dire ou se crée une "figure" ( c'est quelque chose qui fait sens, qu'on peut regarder et comprendre)
3 -
Expliquez « paysage avec figures absentes »
Paysage avec figures absentes. Paysage ou il y a des figures sans être là. On questionne la possibilité d'un sens
La poésie sert a repérer les endroits qui semblent harmonieux et on se demande si cette harmonie est un pur hasard ou le résultat du travail d'une figure divine, reflet d'une harmonie ancienne, reflet de reflets, se demander si elle a un sens = Des lieux dont on se demande s’ils sont sacrés ou non?
III-
une éthique de l'Ouvert
A-
le dédoublement inquiet
1 -
La poésie de Jaccottet est-elle faite de questionnements divers?
Oui sa poésie est moins affaire de certitude que de questionnements et d’inquiétudes.
2 -
Comment le poète transparaît-il dans ce dédoublement inquiet? Expliquez
Il y a la réflexivité du poète qui se dédouble :
-poète percevant
-poète écrivant (qui se dédouble) :
-poète traversé pas des associations d'idées
-poète qui réfléchit à ces associations d'idées
Poète percevant : paragraphe 1 : cette perception est un peu modalisée (je me souviens , identification du poète et du lieu par isotopie de la mémoire,, description objective
Sujet lyrique impersonnel qui se rapporte à un paysage animé
-verbes de perception : découvrir, saisir, comprendre, on regarde, on rêve
2ème et 3ème "je"
Tension entre "je" écrivant et le "je" critique c'est-à- dire réfléchissant à l'écriture
- "je" écrivant : "je pense"
- "je" réfléchissant : "j'imagine", "je devine"
--> les deux : "je pourrais écrire"
- "je" percevant : "mon émotion", "me", "me parlait"
La critique réfléchit à la poésie
III-
une éthique de l'Ouvert
B-
la dialectique de l'image
1 -
Y a-t-il une dévalorisation de l’image?
dévalorisation de l'image // utilisation de l’image
Jaccottet utilise l'image contre l'image
clichés
=> critique des clichés , le poète essaye d'avoir un style singulier en utilisant la langue de tout le monde
2 -
Dans quel but? Quel travail le poète fait-il?
- rythme ternaire. Le poète recherche les images les plus simples ,naturelles, justes or ce ne sont pas les plus simples
--> simplicité = travailler dur pour y aboutir
L22-24 : faire une métaphore en suivant les connotations de l'image est plus difficile que de retourner au sens réel de ce que l'on voit : dire plus que la réalité nous montre
L19 : image à une pente : métaphore filée
--> métaphore qui ne permet pas d'être juste
- en effet l'image doit avant tout redonner le secret du paysage c'est-à-dire ce que l'image doit permettre de comprendre c'est "l'écume m’a touché en tant qu'elle même", "l'eau en tant qu'eau"
- entre autre il ne faut pas que l'image dérive en idylle, image au service de la tautologie (a=a)
III-
une éthique de l'Ouvert
C-
la condition du rapport au monde
1 -
Comment se traduit le rapport à la nature et au monde?
Il n’est pas immédiat. Pour voir vraiment les choses dans leur simplicité, il faut regarder longtemps.
Il faut construire la méditation. Le poète doit construire par les mots en donnant un sens.
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019

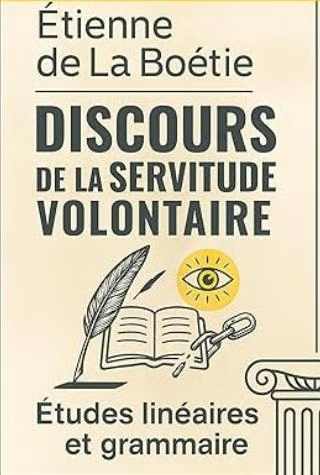
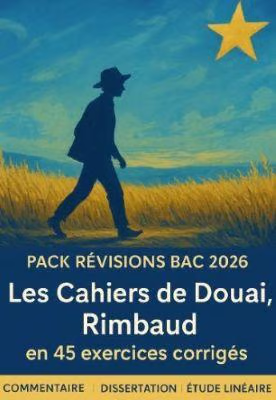
 Littérature d'idées
Littérature d'idées