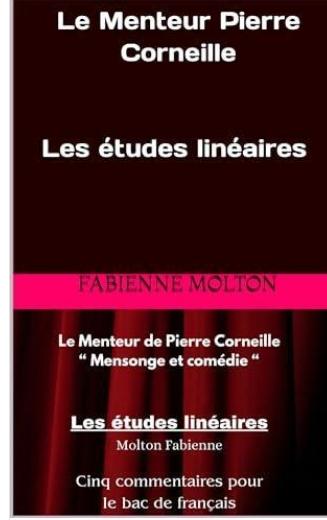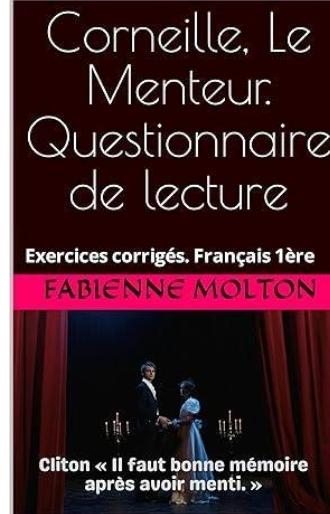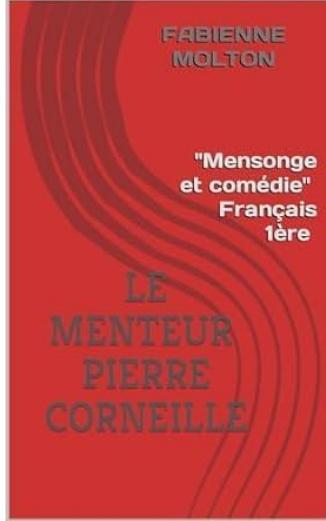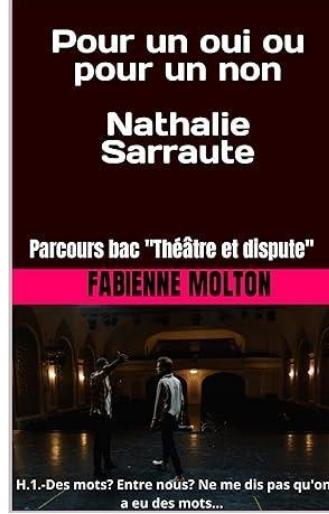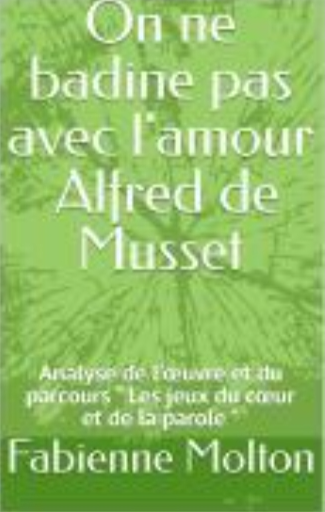Sarraute, Pour un oui ou pour un non, scène d'ouverture. Parcours "théâtre et dispute"
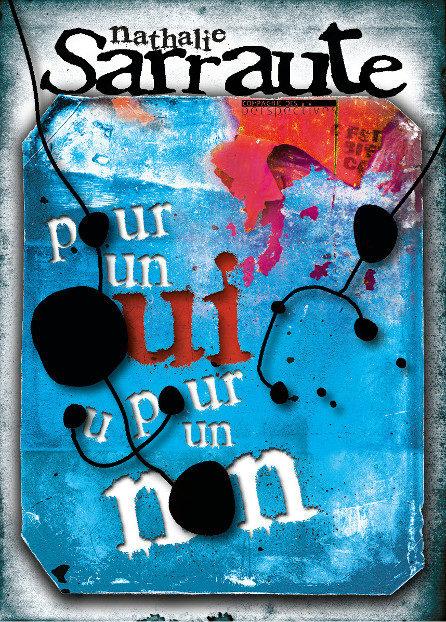
Lecture du passage :
1.Scène d'ouverture du début à « ce n'est pas sans importance »
H.1.-Écoute,je voulais te demander... C'est un peu pour ça que je suis venu... je voudrais savoir... que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi?
H.2.-Mais rien... Pourquoi ?
H.1.-Oh,je ne sais pas... Il me semble que tu t'éloignes... tu ne fais plus jamais signe... il faut toujours que ce soit moi...
H.2.- Tu sais bien : je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger.
H. 1. - Mais pas avec moi? Tu sais que je te le dirais... Nous n'en sommes tout de même pas là... Non, je sens qu'il y a quelque chose...
H.2.-Mais que veux-tu qu'il y ait ?
H.1.-C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher... jamais... depuis tant d'années... il n'y a jamais rien eu entre nous... rien dont je me souvienne...
H.2.-Moi, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic... il y a eu des circonstances...
H.1.-0h qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu as toujours été parfait... un ami sûr... Tu te souviens comme on attendrissait ta mère?... H.2.-0ui, pauvre maman... Elle t'aimait bien... elle me disait: «Ah lui, au moins, c'est un vrai copain, tu pourras toujours compter sur lui.» C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs.
H.1.-Alors? H.2, hausse les épaules. -...Alors... que veux-tu que je te dise!
H.1.-Si, dis-moi... je te connais trop bien : il y a quelque chose de changé... Tu étais toujours à une certaine distance... de tout le monde, du reste... mais maintenant avec moi... encore l'autre jour, au téléphone ... tu étais à l'autre bout du monde... ça me fait de la peine, tu sais...
H.2, dans un élan.-Mais moi aussi, figure-toi...
H.I.-Ah tu vois, j'ai donc raison...
H.2.-Que veux-tu... je t'aime tout autant, tu sais... ne crois pas ça... mais c'est plus fort que moi...
H.1.-Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Il y a donc eu quelque chose...
H.2.-Non... vraiment rien... Rien qu'on puisse dire... H.1.-Essaie quand même... H.2.-Oh non... je ne veux pas... H.1.-Pourquoi? Dis-moi pourquoi?
H.2.-Non, ne me force pas...
H.1.-C'est donc si terrible?
H.2.-Non, pas terrible... ce n'est pas ça...
H.1.-Mais qu'est-ce que c'est, alors?
H.2.-C'est... c'est plutôt que ce n'est rien ... ce qui s'appelle rien... ce qu'on appelle ainsi... en parler seulement, évoquer ça... ça peut vous entraîner... de quoi on aurait l'air? Personne, du reste... personne ne l'ose... on n'en entend jamais parler...
H.1.-Eh bien, je te demande au nom de tout ce que tu prétends que j' ai été pour toi... au nom de ta mère... de nos parents ... je t'adjure solennellement, tu ne peux plus reculer... Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le...tu me dois ça...
H.2, piteusement. - Je te dis : ce n'est rien qu'on puisse dire... rien dont il soit permis de parler...
H.1.-Allons, vas-y...
H.2.-Eh bien, c'est juste des mots...
H.1.-Des mots? Entre nous? Ne me dis pas qu'on a eu des mots... ce n'est pas possible... et je m'en serais souvenu...
H.2.-Non, pas des mots comme ça... d'autres mots... pas ceux dont on dit qu'on les a «eus»... Des mots qu'on n'a pas «eus», justement... On ne sait pas comment ils vous viennent...
H.1.-Lesquels? Quels mots? Tu me fais languir... tu me taquines...
H.2.-Mais non, je ne te taquine pas... Mais si je te les dis...
H.1.-Alors? Qu'est-ce qui se passera? Tu me dis que ce n'est rien...
H.2.-Mais justement, ce n'est rien... Et c'est à cause de ce rien...
H.1.- Ah on y arrive... C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné? Que tu as voulu rompre avec moi?
H.2, soupire. - Oui... c' est à cause de ça... Tu ne comprendras jamais... Personne, du reste, ne pourra comprendre...
H.1.-Essaie toujours... Je ne suis pas si obtus... H.2.-Oh si... pour ça, tu l'es. Vous l'êtes tous, du reste. H.1.-Alors, chiche... on verra...
H.2.-Eh bien... tu m'as dit il y a quelque temps... tu m'as dit... quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi... de je ne sais plus quel succès... oui... dérisoire... quand je t'en ai parlé... tu m'as dit : « C'est bien... ça...»
H.1.-Répète-le, je t'en prie... j'ai dû mal entendre.
H.2,prenant courage.- Tu m'as dit : «C'est bien... ça...» Juste avec ce suspens... cet accent...
H.1. -Ce n'est pas vrai. ça ne peut pas être ça... ce n'est pas possible...
H.2.Tu vois, je te l'avais bien dit... à quoi bon?...
H.1.-Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
H.2.-Oui. Très. Très sérieusement.
H.1.-Écoute, dis-moi si je rêve... si je me trompe... Tu m'aurais fait part d'une réussite... quelle réussite d'ailleurs...
H.2.-Oh peu importe... une réussite quelconque...
H.1.-Et alors je t'aurais dit : « C'est bien, ça? »
H.2, soupire.- Pas tout à fait ainsi... il y avait entre «C'est bien» et «ça» un intervalle plus grand : «C'est biiien... ça... » Un accent mis sur «bien»... un étirement : «biiien...» et un suspens avant que «ça» arrive... ce n'est pas sans importance.
Parcours bac : "Théâtre et dispute"
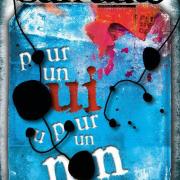 Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non
Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non
"Théâtre et dispute"
- Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
- La scène d'ouverture : "C'est bien çà..."
- ** Séquence "le théâtre"
- Parcours bac : "Théâtre et dispute"
- Problématique : Est-ce une scène d'exposition?
- I - Le caractère inattendu (ce qui ne correspond pas à une scène d'exposition)
- II. Cependant quelques repères Caractéristique du théâtre
- III. Cette ouverture rend compte du sujet (intrigue) de la pièce
- "C'est bien ça..."
Date de dernière mise à jour : 06/12/2023

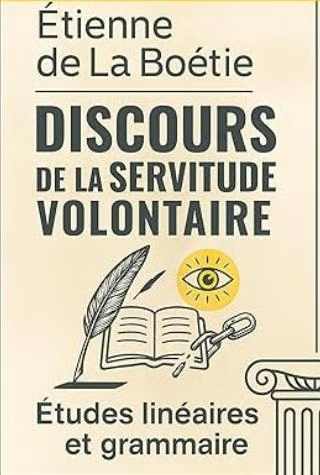
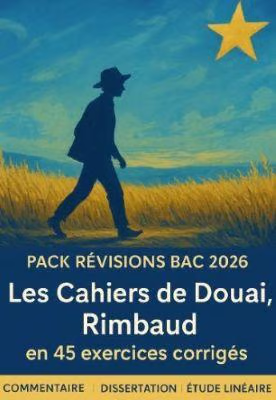
 Littérature d'idées
Littérature d'idées 





 ème visiteur
ème visiteur