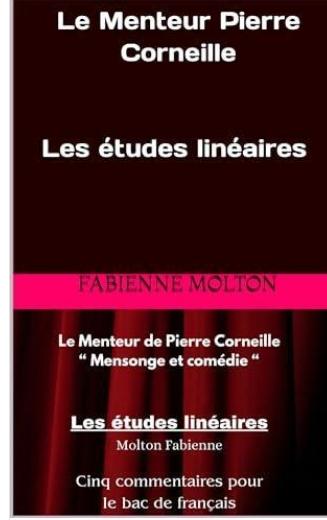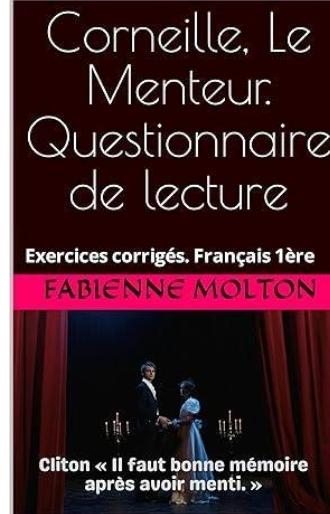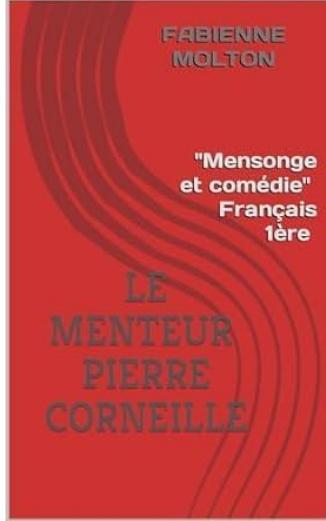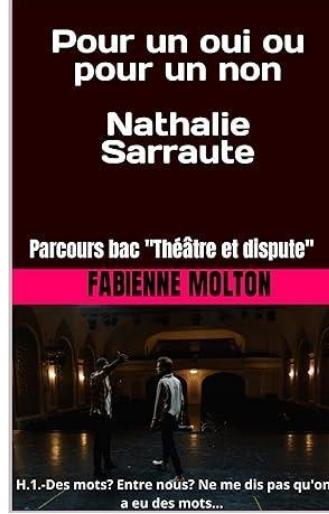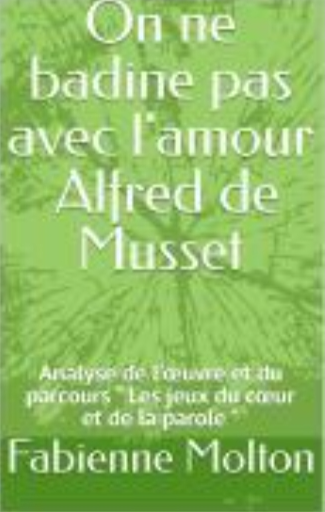Sarraute, Pour un oui ou pour un non, les commentaires du site. "Théâtre et dispute"
Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non
"Théâtre et dispute"
- Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
- La scène d'ouverture : "C'est bien çà..."
- ** Séquence "le théâtre"
- Parcours bac : "Théâtre et dispute"
- Problématique : Est-ce une scène d'exposition?
- I - Le caractère inattendu (ce qui ne correspond pas à une scène d'exposition)
- II. Cependant quelques repères Caractéristique du théâtre
- III. Cette ouverture rend compte du sujet (intrigue) de la pièce
- « La vie est là » de « Tu comprends pourquoi je tiens... » à « dans le « poétique »
- Problématique : Comment cette scène met elle en avant la force des tropismes ?
- Parcours bac : "Théâtre et dispute"
- Perspectives: Détournement des conventions théâtrales, l'écriture de Sarraute et les tropismes, le théâtre de Beckett et l'absurde.
- I. Ces tropismes atteignent H1 (d'où le retournement de situation)
- II. Les tropismes envahissent le langage ( images identiques et double sens)
- Scène finale de « H.1.- Oui... il me semble que là où tu es tout est... » à la fin.
- Mise en scène du langage
- Parcours bac : "Théâtre et dispute"
- Problématique : Cette scène est-elle une scène de rupture ou de réconciliation ?
- I. Deux univers
- II. Une commune envie de rompre un accord paradoxal
- III - La fin
Commentaires / Repérages
Date de dernière mise à jour : 06/12/2023
Les commentaires sont clôturés
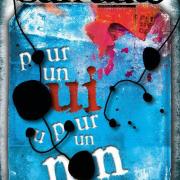

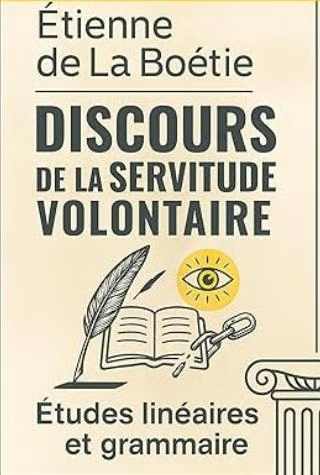
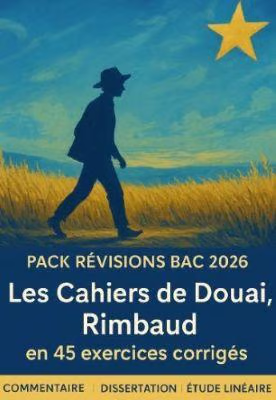
 Littérature d'idées
Littérature d'idées 




 ème visiteur
ème visiteur