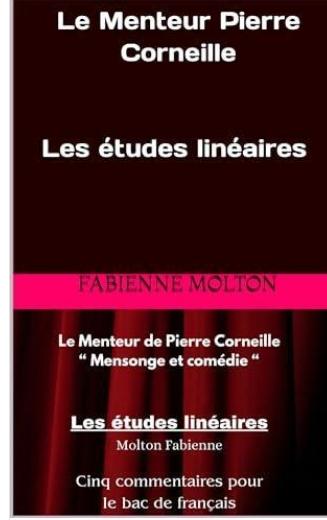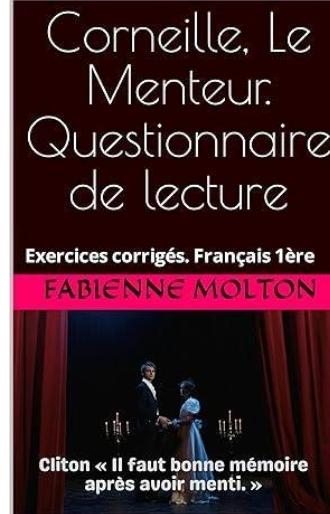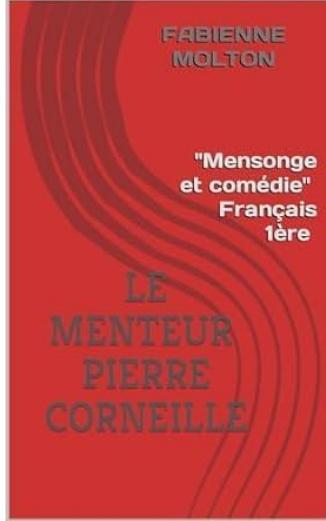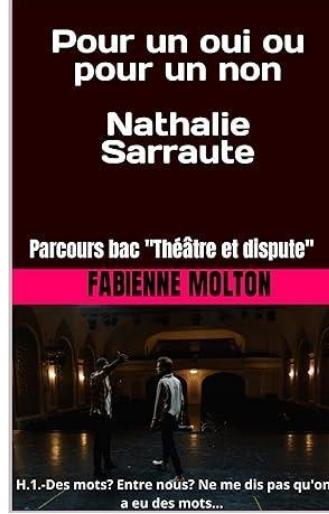Le retour des mythes, la réécriture des tragédies

*** Lecture en ligne
- Les corrigés du baccalauréat de français
- Série générales
Le retour des mythes, la réécriture des tragédies
L'analyse de niveau bac est intégralement rédigée et comprend une introduction, un très long développement sur la question et une introduction avec une ouverture.
Sujet de réflexion :
Le retour aux mythes, réécriture des tragédies dans l'histoire du théâtre et réflexion sur le genre tragique
Sujet :
Le retour des mythes constitue un fait majeur dans l’histoire du théâtre français du XXème siècle. On assiste en effet, entre les deux guerres mondiales et au début de la seconde, à la réécriture des tragédies héritées de l’âge d’or antique. Avec ce retour au mythe s’engage une réflexion sur le genre tragique en plein renouvellement. Jean Anouilh écrit dans Antigone que la tragédie est reposante parce qu’on sait « qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos ».
Cette conception de la tragédie s’inscrit dans une vision pessimiste de l’action humaine et la tonalité ironique de la citation nous fait douter du caractère reposant de la tragédie dont les enjeux semblent appeler à la réflexion par un effet de distanciation propre à combler l’horizon d’attente du spectateur moderne.
Eléments pour une dissertation rédigée
Cet horizon d’attente semble, a priori, borné de tous côtés par l’absence d’espoir, par l’action écrasante du destin et surtout par la conscience même que les hommes ont de leur impuissance. En somme, la tragédie selon Jean Anouilh développe une vision plutôt pessimiste de l’action humaine.
Il est vrai que la reprise des mythes antiques contraint les dramaturges à faire périr Antigone et Jocaste, à souiller les mains d’Oreste du sang d’Egisthe et de Clytemnestre, à crever les yeux d’Oedipe. A moins de transgresser radicalement l’héritage, ce qui est culturellement délicat, il faut s’en tenir au schéma narratif antique. Connaissant la légende, le spectateur sait que quoi qu’il fasse, le héros progresse sur une voie en impasse pour lui. Le prologue d’Antigone de Jean Anouilh met à plat la carte du parcours que vont effectuer les personnages pendant le temps de la représentation, discours programmatique où l’on apprend qu’Antigone « pense qu’elle va mourir… mais il n’y a rien à faire. Elle s’appelle Antigone et il va falloir qu’elle joue son rôle jusqu’au bout ». Plus incontournable encore est la guerre de Troie. Le défi que lance le titre de la pièce suggère, avec une tragique acuité, la pauvre illusion des hommes. La guerre de Troie a eu lieu : Jean Giraudoux ne pouvait faire fi d’une réalité vieille de trente siècles, même s’il n’ouvre les portes de la guerre qu’après nous avoir fait croire au rêve de paix.
Les dramaturges du XXème siècle n’ont guère transgressé le schéma narratif du conte originel mais par contre ils ont creusé, plus encore que ne le firent Sophocle, Eschyle et Euripide, l’horreur, la profondeur du piège dans lequel sont enfermés les personnages. Le caractère inéluctable du destin des personnages et des hommes par assimilation, est tout entier dans l’inhumaine machine destinée à l’anéantissement mathématique d’un mortel. Tous les rouages sont parfaitement huilés. On ne peut s’empêcher de penser au film de C. Chaplin, les temps modernes, avec ses énormes engrenages qui broient les hommes sans jamais s’enrayer. Jean Cocteau a fait de cette machine infernale, le rôle-titre de sa pièce, allégorie du fatum, ce destin remonté à bloc, contre lequel se brisent les illusions. Le même aveuglement gouverne l’action d’Œdipe et de Jocaste chez Sophocle comme chez Cocteau. Ce dernier le rappelle dès l’ouverture : « avec son écharpe rouge, Jocaste se pend. Avec la broche d’or… Œdipe se crève les yeux ». Les héros sont pris comme des rats, bêtes immondes eux-mêmes écrasés par un ciel synonyme de divinités infernales, de destin mauvais mais aussi de courte vue, voire d’incompréhension. Jocaste dit mais ignore paradoxalement que son écharpe lui veut du mal. Et les exemples sont nombreux de situations qui trahissent l’enfermement du personnage dans un espace clos alors même qu’il croit s’en être échappé, comme Œdipe fuyant Corinthe, ou qu’il croit évoluer librement, comme Oreste dans les Mouches, ou bien enfin comme Egisthe renaissant se métamorphosant en roi bon et noble, mais trop tard dans un univers où la rédemption passe par la mort.
L’intérêt de toute œuvre est là : dans le contraste entre ce que croit savoir le héros et ce que sait le spectateur, à moins que ce soit l’inverse…. L’Oreste de Sartre sait qu’il est libre. La pièce est construite sur cette certitude. Il accomplit l’acte criminel et le revendique devant le peuple d’Argos au nom de sa liberté, mais il sait aussi qu’il sera « un roi sans terre et sans sujet », un exilé, la victime qui s’offre en sacrifice allègrement pour purifier la ville de ses mouches, c’est-à-dire, de son parricide. Ce joueur de flute est d’autant plus pathétique qu’il apparait au spectateur dans toute la gloire de son impuissance humaine à concilier tous les bonheurs. Son bonheur apparait plutôt comme un bagne.
Plus frappante encore est l’impuissance d’Egisthe. Lui sait qu’il est perdu, quoi qu’il fasse. Mais la situation n’est guère plus confortable du côté du spectateur qui sait qu’Electre et Antigone s’enferrent dans leur fatale obstination, qui sait aussi combien Œdipe est imperméable aux avis de Tirésias, qui mesure enfin l’effarement de Cassandre dont la parole est récusée. Le spectateur sait aussi que ce qui fait le tragique du personnage, quel qu’il soit, est l’acceptation du dilemme, de l’impasse, de l’échec, de la folie, et il pressent que se joue sur scène la comédie de sa propre humanité.
Et de celle-ci on serait tenté de dire qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer. C’est un peu ce que suggère Jean Anouilh en essayant de nous faire croire que la tragédie est « reposante ». L’acception est ironique et nous invite à entrer en travail dès lors que se lève le rideau de scène, pour la simple raison que l’universalité du mythe réserve au dramaturge, jusqu’à l’issue connue d’avance, un espace dont lui seul est le maître pour engager un rude combat à la vie, à la mort.
Ce n’est pas parce que le héros sait qu’il est condamné qu’il se laissera couler sans combattre. Si tel était le cas, le mythe ne serait pas un et le sujet n’eût présenté aucun intérêt. L’intérêt réside précisément dans l’espoir cultivé aussi bien par le héros que par le spectateur. « Je ruse en ce moment contre le destin » dit Ulysse à Hector heureux que l’issue du débat soit la paix entre les deux nations grecque et troyenne. Le spectateur, qui est venu voir la guerre de Troie n’aura pas lieu, a fini lui aussi par souhaiter cette paix parce que lui aussi, en 1935, a entendu des bruits de bottes et des ronflements d’automitrailleuses de l’autre côté du Rhin. De même Créon plaidant pour Antigone la cause de l’adulte et chef d’état responsable d’un peuple, plaidant la cause du devoir, dénonçant les idéaux, les utopies de tous les « petits créons maigres et pâles qui comme Antigone, sont prêts à mourir tout en s’avouant, « je ne sais plus pourquoi je meurs. J’ai peur … » Créon espère lui aussi que sa nièce épousera Hémon, aura de beaux enfants. Il croit encore au bonheur. Résiste, tel est le conseil de Jupiter à Egisthe. Tous font de la résistance. L’Electre de Giraudoux résiste au point de se pétrifier dans son « sale espoir », statue de marbre insensible, elle aussi, aux raisons et à la raison d’Egisthe-roi. En résistant contre l’implacable destin, les héros se vouent à la souffrance.
Certes, le lot du personnage tragique est la souffrance morale. Qui n’a pas en mémoire les cris raciniens de Phèdre à bout de résistance ? L’Electre de Jean Paul Sartre est vaincue par le remords au moment où sa vengeance est accomplie. « J’ai vieilli. En une nuit » dit-elle, et plus loin : « je consacrerai la vie entière à l’expiation ». Au lieu de se libérer, elle s’est enfermée dans une continuité, celle de la malédiction des Atrides qui fonctionne comme fatum. La tragédie, dans ces conditions, n’apparait guère reposante pour les héros dévorés par l’hybris, c’est-à-dire par l’intolérable supériorité qui les fait sortir du commun des mortels et qui les désigne à la vindicte publique puisqu’il faut couper la tête qui dépasse.
Anubis dans la Machine infernale peint Œdipe et à travers lui les hommes « aveugles et ils ne s’en aperçoivent que le jour où une bonne vérité leur crève les yeux ». La résistance d’Œdipe ou plus exactement sa non clairvoyance puisque c’est de cela qu’il s’agit, est pathétique, aussi bien devant les portes de Thèbes que lors des altercations avec Tirésias. Toute la tension de la tragédie est montée sur ce ressort d’aveuglement dont la rupture au dénouement, « lumière est faite » produit le retournement de l’espoir en « sale espoir » et de la joie de vivre de l’homme sûr de lui en haine de soi : « qu’on abatte la bête immonde ». Œdipe ne sait plus que répéter : « ne me touche pas » à qui l’approche. Tirésias résume la mutation : « il a voulu être le plus heureux des hommes, maintenant il veut être le plus malheureux ». Le combat continue. Œdipe accepte l’inacceptable en acceptant la cécité physique. « Mieux valait la mort » s’étonne Créon.
Œdipe a choisi le châtiment. On pourrait dire la même chose d’Oreste dans les Mouches. Il a choisi une forme de liberté que nous jugeons paradoxale comparée à celle de l’Oreste déraciné du début de la pièce. Le personnage en quête d’une identité, plus exactement d’une mémoire collective, s’est enraciné dans les conséquences d’un acte qu’il assume jusqu’au bout parce que tel est son destin. Nous retiendrons surtout que ce destin est son œuvre. Aucune force divine ne l’aide ni ne l’entrave. Il est l’image de l’individu dans toute sa laïcité. Jupiter n’en a pas été le maître. La vraie vie de l’homme libre commence de « l’autre côté du désespoir » lit on dans l’acte III des Mouches, non point du côté de la lutte contre la marche du destin. Electre offre chez Giraudoux l’exemple extrême de l’inacceptable : la destruction d’Argos. La femme Narsès fait le bilan de la situation : « tout est gâché… tout est saccagé… on a tout perdu… la ville brûle… les innocents s’entre tuent ». Tel est le résultat de sa résistance obstinée, du refus d’Electre de transiger.
Le spectateur sait bien que la vengeance doit s’accomplir mais Giraudoux se démarque des anciens en construisant dans une province encore déserte pour reprendre l’image de M. Yourcenar. L’inacceptable, c’est-à-dire le chaos final est comme la réitération apothéotique des paradoxes constituant la définition de la tragédie telle que l’énonce le jardiner : « une entreprise d’amour et de cruauté ». Tous y devient « signe » prend une valeur signifiante. Le meurtre de Demokos par Hector a pour fin de taire le « chant de guerre » qui deviendra l’inacceptable mensonge aléatoire sans lequel la guerre n’eût pas eu lieu, ce qui aurait été inacceptable au regard du mythe et de l’histoire.
Parce que l’horizon d’attente du lecteur et du spectateur prévoit l’ouverture des portes de la guerre. Nous avons dit combien les mythes antiques sont ancrés dans notre culture. Si bien que ceux-ci dans la tragédie du XXème siècle, ont favorisé un renouvellement de l’écriture de la tragédie. La définition qu’en donne Anouilh suggère même des enjeux comparables à ceux des performances d’un instrument d’optique capable d’offrir la vision distanciée, panoramique, d’une problématique humaine aveuglante.
Bien sûr cette distance est en premier lieu le fruit de l’écriture, de la réécriture du mythe antique. L’écriture pose le sujet dans un espace-temps indécidable et lointain, légendaire, sans rapport fonctionnel avec la contemporanéité. Pensons au palais allégorique d’Argos, à la métamorphose des Euménides par exemple, à l’attaque des Corinthiens. Dans notre réalité, le sphinx est une statue égyptienne : Œdipe conduit par Antigone prend le corps que lui a donné un peintre. Seuls les arts et la littérature réfèrent aux personnages mythologiques. On ne peut plus grande distance. Celle-ci est d’ailleurs amplifiée par nombre d’anachronismes par rapport au modèle antique, tels que la cigarette du garde d’Antigone, la chemise ou le veston de Créon, « l’épée » ou le sabre dans les Mouches. Ces anachronismes ainsi que les fantaisies langagières puisées dans le catalogue du XXème siècle, contribuent assurément à démystifier l’idée d’une tragédie figée dans ses traditions amidonnées. L’effet recherché, nous pouvons le supposer est d’intéresser le spectateur au discours bien plus qu’à la fable qui elle n’offre guère de surprises. En ce sens, la tragédie du XXème siècle ne se démarque pas de celle du XVIIème siècle recherchée par les amateurs pour ses qualités poétiques à une époque où tout le monde connaissait l’histoire romaine, autant que la mythologie gréco latine. Cependant, l’analogie s’arrête là. La liberté stylistique des dramaturges du XXème siècle dénote une rupture avec le genre défini par Boileau. Ce qui apparait comme une réflexion sur la langue est inévitablement aussi réflexion sur le monde.
Roland Barthes explique dans Essais critiques, que l’écrivain « est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire ». Or le « comment écrire », nous l’avions déjà pressenti, est indissociable d’un « pourquoi ». La date de création de chacune des œuvre étudiées est un indice : de 1934 à 1944. L’avant-guerre et la seconde guerre mondiale avec l’occupation et la résistance. C’est un monde où chacun est « pris comme un rat », peine et souffre parce que fait comme un rat, il est privé de liberté, privé de bonheur, d’amour, de fraternité. Tout espoir s’avère « sale espoir » à cause des trahisons, des exactions de toutes sortes. Le monde dans lequel sont nées nos œuvres est un monde sans repos ni trêve, malade de la guerre, comme chez Giraudoux, ou de la peste comme chez Cocteau, ou de la médiocrité comme chez Sartre. Si bien que par la tragédie, le mot devient le principal personnage. Le jardinier d’Electre insiste sur cette noce du maître avec un mot, noce d’amour qui fait du dramaturge cette voix qui prophétise et de la tragédie le verre grossissant ou, inversement, rapetissant la légende afin que se glisse entre elle et le spectateur, par les mots, l’épaisseur plus ou moins dense du vrai motif de l’œuvre : le monde contemporain de l’écriture.
Parce que ce monde était en cirse de désespérance, nous comprenons le pessimisme de J. Anouilh à travers l’ironie aigre douce qui définit la tragédie comme un genre paradoxal où les souffrances et les misères, les maux d’une humanité responsable d’elle-même depuis le crépuscule des dieux s’unissent à la poétique des mots sur le mode oxymoronique du « sale espoir ». Ce jeu de contrastes invite à la réflexion quasi philosophique intellectualisant ainsi le mythe sans que pour autant soit exclue l’émotion poétique, le plaisir tant recherché au XVIIème siècle. Au contraire, s’établit une cohésion des différences grâce semble-t-il à la distance instaurée par l’ironie même entre le dit et le signifié, enter le montré et l’imaginé. Or il y a distanciation parce que la tragédie dans laquelle s’inscrit le mythe antique ne déçoit en rien l’attente du spectateur toujours surpris par l’angle d’attaque toujours différent de l’espoir et de son contraire. Et cela est à la fois rassurant et reposant parce que le spectateur comme le lecteur repose ailleurs, sur le dos du personnage fictionnel, la charge de tragique qui l’écrasait.
Date de dernière mise à jour : 16/05/2019

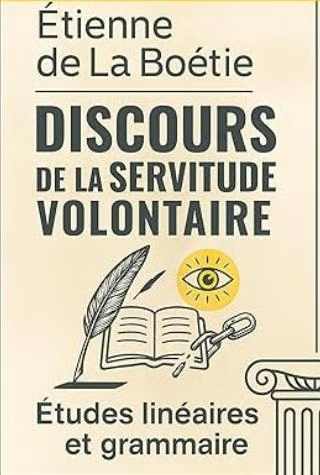
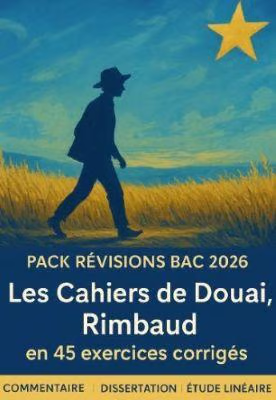
 Littérature d'idées
Littérature d'idées