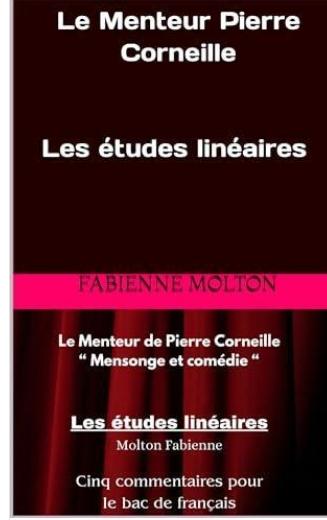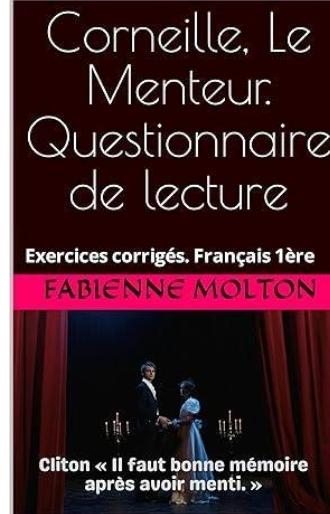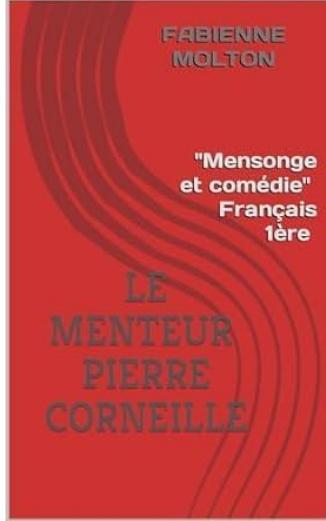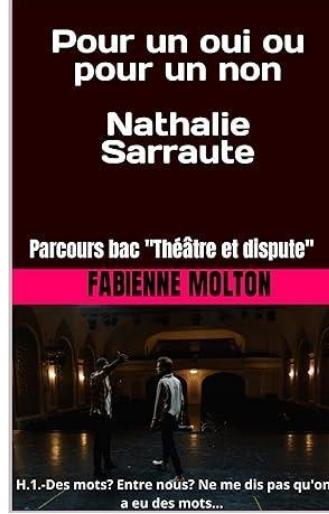Le concert de feu, Natacha : Christophe Marmorat
|
A consulter :
|
|
Le concert de feu Natacha
-
(Concerto n°23, Adagio, KV 488, WA Mozart)
Nous sommes le premier dimanche de décembre 1989, Boulevard Voltaire, dans l’appartement parisien que nous occupons depuis trente ans avec Natacha et nos trois
filles.
Malgré tout, Natacha est morte depuis dix ans déjà, fauchée par une voiture un petit matin de brouillard, près de la Bastille. Elle est décédée au service des urgences de l’Hôpital Saint-Antoine.
Dans le grand salon, assis autour de la longue table basse en verre, je devise avec nos filles, Gabrielle, Astrid et Lucie. Ceci est notre communion laïque, notre grande messe dominicale à nous.
Comme nous jubilons à tester des arguments, développer des théories, à imposer un point de vue. Ces joutes verbales nourrissent chacun de nous, au delà de son âge, de son rang.
Nous évoquons l’histoire du couple franco-allemand au regard de la chute du Mur de Berlin, le rôle à venir de l’Eglise Orthodoxe dans la Russie post-soviétique qui s’annonce, l’avenir du socialisme à la française.
Je regarde mes trois filles avec fierté et bonheur.
Je réalise combien elles se préparent bien à devenir des êtres autonomes parés pour des années difficiles où le monde avancera en toute liberté.
Elles iront au monde avec des convictions, les leurs, une foi profonde en l’humanité, la leur.
Le monde évoluera, la géométrie geo-politique du monde changera, il y aura peut-être une nouvelle révolution, ou pas, mais Gabrielle, Astrid et Lucie pourront affronter ces changements, s’y confronter fortes de leur capacité à comprendre, à analyser, fortes de leurs convictions et de leurs valeurs.
Elles y déploieront leur humanité.
Soudain, au milieu d’un bref silence Lucie se lève. Du haut de ses quinze ans elle traverse le salon avec calme, naturelle. Elle se dirige vers le piano. On entend le frottement de ses cuisses à travers son jeans. Elle porte un pull en angora blanc. Elle a rassemblé sa longue et fine chevelure brune avec une pince qui découvre joliment sa nuque.
Elle s’assoie, positionne une partition, semble compter des temps.
A son visage, à son large demi-regard brillant, on comprend qu’elle est déjà partie de l’autre côté de l’existence, celui du bon tempo, celui de la beauté.
Celui qu’elle aime à fréquenter plus que tout depuis qu’elle est née.
J’ai parfois l’impression que nous avons adopté Lucie, ou plutôt que c’est elle qui nous a adopté, choisi, désigné. J’ai parfois des doutes scientifiques, ou bien devrais-je dire métaphysique sur notre lien de sang.
Même le Conservatoire la regarde étrangement, telle une petite chamane.
Elle place ses mains au dessus du clavier, ajuste le placement de son dos, bien droit. Et elle nous fait entendre les premières notes de l’adagio du concerto 23 de Mozart.
Nous sommes figés, presque glacés par sa manière de jouer.
Oui il s’agit bien d’une glaciation, d’une cristallisation, celle du temps, pris, serti dans les glaces d’un magique instant.
Je manque de me lever pour vérifier que ses doigts touchent le clavier.
Sa grâce angélique me bouleverse et je pleurs.
Autant de beauté, d’une beauté universelle, d’une beauté intemporelle, transmise par un si jeune être, ma fille.
Autant de justesse, autant de délicatesse, autant de finesse, de précision, autant d’émotion émane du geste virtuose.
Je ne sais plus si Lucie à quinze ou quarante ans, à ce moment, au moment où elle joue du Mozart si délicatement, et avec autant de vérité, précisément.
Et puis, je me décide à relever la tête mais lentement, groggy par tant d’émotion. Mes yeux se portent sur l’ombre de Lucie projetée sur un mur du salon et je comprends.
Je comprends, je reconnais, je vois la silhouette de ma femme Natacha, je vois essentiellement sa grâce infinie.
Je reconnais le tournoiement de son buste, elle valse au dessus du clavier, son corps n’est plus qu’une danse et ce sont les mouvements de la danse qui donne le tempo au piano.
Je reconnais ses mains en suspension dans les airs, je reconnais sa manière à elle de toucher le clavier.
Lucie n’avait pas cinq ans lorsque Natacha est partie.
Lucie doit avoir quelques images, quelques notes floues, de sa maman jouant du piano.
Je sais que Natacha aimait jouer avec Lucie sur ses genoux.
Et aujourd’hui c’est Lucie qui porte sa maman.
C’est Lucie qui pose ses mains sur les cuisses et laisse le clavier à Natacha et je l’en remercie.
Versailles, le samedi 8 janvier 2011.
Date de dernière mise à jour : 31/10/2018


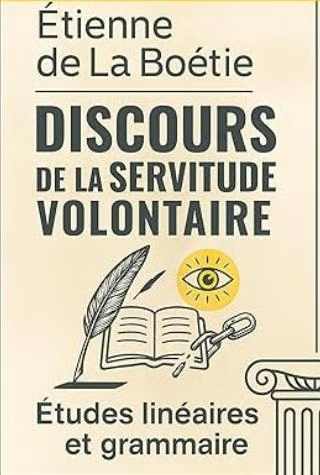
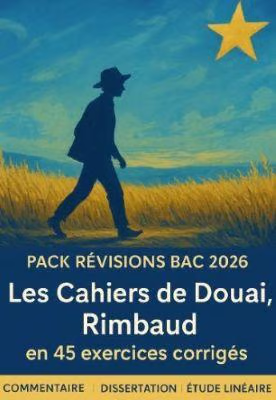
 Littérature d'idées
Littérature d'idées 



 ème visiteur
ème visiteur