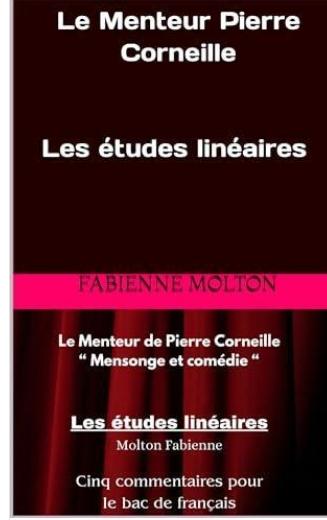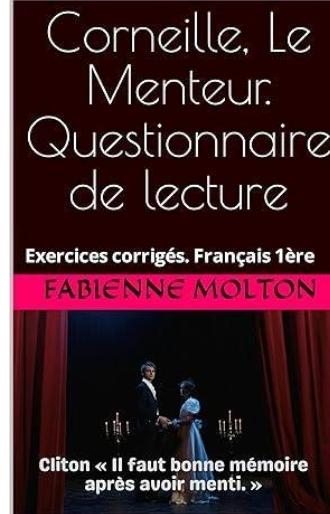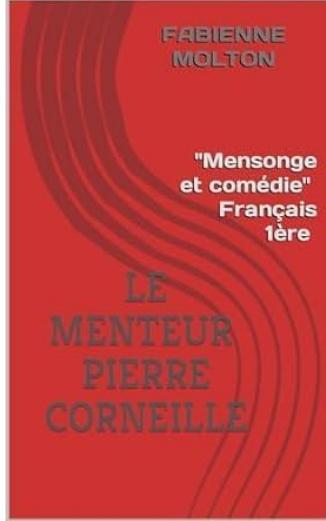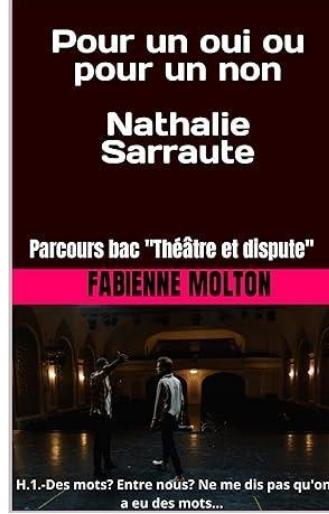Groupement EAF : les sources de Phèdre : le texte théâtral dans sa représentation

OBJET D’ETUDE : LE THEATRE
Le texte théâtral dans sa représentation du XVIIe siècle à nos jours
Jean Racine, Phèdre
GROUPEMENT : Les sources de Phèdre
Texte 1 : Euripide, Hippolyte (-428 av. J. Ch.)
Texte 2 : Sénèque, Hippolyte (1er s. ap. J. Ch.). La pièce s’est par la suite intitulée Phèdre.
Texte 3 : Ovide, Les Métamorphoses, « Myrrha » (Ier siècle ap. J. Ch.).
Texte 4 : Ovide, Les Héroïdes, « Phèdre et Hippolyte »(1er s. ap. J. Ch.).
Dans la préface de 1677, Racine évoque ses sources, et principalement le poète grec Euripide (484-406 av. J.-C.), qui dans sa tragédie Hippolyte(428) avait traité le mythe de Phèdre. Dans cette pièce, le héros est poursuivi par la déesse de l'amour, Aphrodite, qui dès les premiers vers clame sa fureur d'être délaissée par le jeune homme au profit d'Artémis. Dans Phèdre, Vénus s'acharne contre la famille de la reine, dont l'ancêtre, le Soleil, avait révélé les amours coupables de la déesse et de Mars. La fatalité prend ainsi la forme de cette haine implacable attachée à toute la descendance du Soleil.
Sénèque, philosophe et poète romain du premier siècle après J.-C., est également l'auteur d'une tragédie consacrée à ce sujet. Le récit de Théramène, dans toute son horreur, doit beaucoup à cette source sur laquelle Racine insiste moins. Les ravages de la passion comme maladie de l'âme, ont été également explorés par les Anciens. Citons encore Myrrha, les Héroïdes d'Ovide, et l'Enéide de Virgile, en particulier les amours de Didon et Enée.
"Fille de Minos et de Pasiphaé", Phèdre appartient à une famille illustre : son père est l'un des juges qui siègent aux Enfers. Dans La Poétique, Aristote indique que les héros de tragédie, contrairement aux personnages de comédie, sont de noble extraction. Les conflits tragiques sont donc à la fois personnels et politiques : la mort de Thésée ou la faute de Phèdre ont des conséquences au plus haut niveau de l'Etat.
Racine a pu aussi s’inspirer de deux récits d’Ovide, poète latin du 1er siècle après J. Ch., qui a consigné toute la mythologie gréco-latine dans ses Métamorphoses.
-
Euripide, Hippolyte
LA NOURRICE
Allons, ma chère enfant, oublions toutes deux notre premier entretien ; reprends ta douceur naturelle, éclaircis ton front soucieux et tes sombres pensées : et moi, si j'ai eu des torts en suivant ton exemple, je les désavoue, et je veux prendre un autre langage pour te plaire. Et si tu es atteinte d'un mal secret, ces femmes m'aideront à soulager ta souffrance : mais si ton mal peut être révélé à des hommes, parle, pour qu'on en instruise les médecins. Bien. Pourquoi ce silence? Il ne faut pas te taire, ma fille, mais me reprendre si je me trompe, ou suivre mes avis s'ils sont bons. Dis un mot, tourne un regard vers moi. O que je suis malheureuse ! Femmes, vous le voyez , toutes mes peines sont vaines; je n'ai avancé en rien : tout à l'heure mes paroles n'ont pu la toucher, et maintenant elles ne peuvent la fléchir. Mais sache-le bien, dusses-tu te montrer plus farouche que la mer, si tu meurs, tu trahis tes enfants, ils n'auront point part aux biens de leur père : j'en atteste cette fière Amazone qui a donné un maître à tes fils, un bâtard dont les sentiments sont plus hauts que la naissance. Tu le connais bien, Hippolyte.
PHÈDRE.
Ah dieux !
LA NOURRICE.
Ce reproche te touche ?
PHÈDRE.
Tu me fais mourir, nourrice ; au nom des dieux, à l'avenir garde le silence sur cet homme.
LA NOURRICE.
Vois donc ! ta haine est juste, et cependant tu refuses de sauver tes fils et de prendre soin de tes jours.
PHÈDRE.
Je chéris mes enfants ; mais ce sont d'autres orages qui m'agitent.
LA NOURRICE.
Ma fille, tes mains sont pures de sang.
PHÈDRE.
Mes mains sont pures, mais mon cœur est souillé.
LA NOURRICE.
Est-ce l'effet de quelque maléfice envoyé par un ennemi?
PHÈDRE.
C'est un ami qui me perd malgré lui et malgré moi.
LA NOURRICE.
Thésée t'a-t-il fait quelque offense?
PHÈDRE.
Puissé-je ne l'avoir point offensé moi-même !
LA NOURRICE.
Quelle est donc cette chose terrible qui te pousse à mourir?
PHÈDRE.
Laisse là mes fautes : ce n'est pas envers toi que je suis coupable.
LA NOURRICE.
Non, je ne te laisserai pas ; je ne céderai qu'à ton obstination.
PHÈDRE.
Que fais-tu? Tu me fais violence en t'attachant à mes pas.
LA NOURRICE.
Je ne lâcherai point tes genoux que je tiens embrassés.
PHÈDRE.
Malheur à toi si tu apprends ce malheureux secret!
LA NOURRICE.
Est-il un malheur plus grand pour moi que de te perdre?
PHÈDRE.
Tu me perds : le silence faisait du moins mon honneur.
LA NOURRICE.
Et cependant tu caches ce qui t'honore, malgré mes supplications.
PHÈDRE.
Pour couvrir ma honte, j'ai recours à la vertu.
LA NOURRICE.
Si tu parles, tu en seras donc plus honorée.
PHÈDRE.
Va-t'en, au nom des dieux! et laisse mes mains.
LA NOURRICE.
Non, certes, puisque tu me refuses le prix de ma fidélité.
PHÈDRE.
Eh bien ! tu seras satisfaite : je respecte ton caractère de suppliante.
LA NOURRICE.
Je me tais, car c'est à toi de parler.
PHÈDRE.
O ma mère infortunée, quel funeste amour égara ton cœur !
LA NOURRICE.
Celui dont elle fut éprise pour un taureau? Pourquoi rappeler ce souvenir?
PHÈDRE.
Et toi, sœur malheureuse, épouse de Bacchus !
LA NOURRICE.
Qu'as-tu donc, ma fille? Tu insultes tes proches.
PHÈDRE.
Et moi, je meurs la dernière et la plus misérable !
LA NOURRICE.
Je suis saisie de stupeur. Où tend ce discours?
PHÈDRE.
De là vient mon malheur ; il n'est pas récent.
LA NOURRICE.
Je n'en sais pas plus ce que je veux apprendre.
PHÈDRE.
Hélas ! que ne peux-tu dire toi- même ce qu'il faut que je dise !
LA NOURRICE.
Je n'ai pas l'art des devins, pour pénétrer de pareilles obscurités.
PHÈDRE.
Qu'est-ce donc que l'on appelle aimer?
LA NOURRICE.
C'est à la fois, ma fille, ce qu'il y a de plus doux et de plus cruel.
PHÈDRE.
Je n'en ai éprouvé que les peines.
LA NOURRICE.
Que dis-tu ? O mon enfant, aimes-tu quelqu'un?
PHÈDRE.
Tu connais ce fils de l'Amazone ?
LA NOURRICE.
Hippolyte, dis-tu?
PHÈDRE.
C'est toi qui l'as nommé.
LA NOURRICE.
Grands dieux ! qu'as-tu dit? je suis perdue! Mes amies, cela peut-il s'entendre? Après cela je ne saurais plus vivre : le jour m'est odieux, la lumière m'est odieuse ! J'abandonne mon corps, je le sacrifie ; je me délivrerai de la vie en mourant. Adieu, c'est fait de moi. Les plus sages sont donc entraînées au crime malgré elles! Vénus n'est donc pas une déesse, mais plus qu'une déesse, s'il est possible, elle qui a perdu Phèdre, et sa famille, et moi-même !
LE CHOEUR.
Avez-vous entendu la reine dévoiler sa passion funeste, inouïe? Puissé-je mourir, chère amie, avant que ta raison t'abandonne ! Hélas! hélas! quelles souffrances! O douleur, aliment des mortels ! Tu es perdue, tu as révélé de tristes secrets. Quelle longue suite de misère t'attend désormais! Quelque chose de nouveau va se passer dans ce palais. Il n'y a plus à chercher sur qui tombe la persécution de Vénus, ô malheureuse fille de la Crète !
PHÈDRE.
Femmes de Trézène, qui habitez cette extrémité de la terre de Pélops , souvent, dans la longue durée des nuits, je me suis demandé ce qui corrompt la vie des mortels. Selon moi, ce n'est pas en vertu de leur nature qu'ils font le mal, car un grand nombre ont le sens droit; mais voici ce qu'il faut considérer : nous savons ce qui est bien, nous le connaissons, mais nous ne le Taisons pas ; les uns par paresse, les autres parce qu'ils préfèrent le plaisir à ce qui est honnête. Or, il y a bien des plaisirs dans la vie : les longs entretiens frivoles, l'oisiveté, plaisir si attrayant, et la honte ; il y en a de deux espèces, l'une qui n'a rien de mauvais, l'autre qui est le fléau des familles; et si les caractères propres à chacun étaient bien clairs, elles n'auraient pas toutes deux le même nom. Après avoir reconnu d'avance ces vérités, il n'est sans doute aucun breuvage capable de me corrompre au point de me jeter dans des sentiments contraires. Mais je vais vous exposer la route que mon esprit a suivie. Après que l'amour m'eut blessée, je considérai les meilleurs moyens de le supporter. Je commençai donc dès lors par taire mon mal et par le cacher ; car on ne peut en rien se fier à la langue, qui sait fort bien donner des conseils aux autres, mais qui est victime des maux qu'elle s'attire elle-même. Ensuite je résolus de résister au délire de ma passion, et de la vaincre par la chasteté. Mais enfin, ne pouvant, par ce moyens, triompher de Vénus, mourir me parut être le meilleur parti : personne ne condamnera ces résolutions. Puisse, en effet, ma vertu ne pas rester cachée, et mon déshonneur ne point avoir de témoins! Je ne m'abusais pas, je connaissais l'infamie de ma passion ; je savais d'ailleurs que j'étais femme, objet de haine pour tous. Périsse misérablement la femme qui, la première, souilla le lit conjugal par l'adultère ! C'est des nobles familles que cette corruption commença à se répandre parmi les femmes; car quand le crime est en honneur auprès des gens de bien, certes il doit l'être bien plus auprès des méchants. Je hais aussi ces femmes qui, chastes en paroles, se livrent en secret à des désordres audacieux. De quel front, ô Vénus ! osent-elles lever les yeux sur leurs époux? Ne redoutent-elles point les ténèbres, complices de leurs crimes? ne craignent-elles pas que les voûtes de leurs maisons ne prennent la parole pour les accuser? Voilà, chères amies, voilà ce qui me décide à mourir; je ne veux point déshonorer mon époux et les enfants dont je suis mère : qu'ils puissent habiter la noble Athènes, libres, florissants, parlant sans crainte, et glorieux de leur mère; car l'homme, même le plus intrépide, devient esclave dès qu'il a à rougir de sa mère ou de son père. On le dit avec raison , le seul bien préférable à la vie , c'est un cœur juste et honnête. Le temps dévoile les méchants, lorsque le moment est venu, comme un miroir reproduit les traits de la jeune fille qui s'y contemple : que jamais on ne m'associe à leur nombre !
LE CHOEUR.
Ciel ! que la vertu est belle, et quels glorieux hommages elle obtient parmi les mortels !
LA NOURRICE.
O ma maîtresse, tout à l'heure, il est vrai, ton malheur m'a inspiré soudain un effroi terrible : mais à présent je reconnais mon erreur; et, chez les hommes, la réflexion est plus sage d'ordinaire que le premier mouvement. Ce qui t'arrive n'a en effet rien d'extraordinaire, ni qui surpasse la raison ; la colère d'une déesse s'est appesantie sur toi. Tu aimes : qu'y a-t-il d'étonnant? c'est le partage de bien des mortels. Et faut-il que l'amour te fasse renoncer à la vie? Malheur à ceux qui aiment ou qui aimeront désormais, si la mort est le prix qui leur est réservé ! Vénus est irrésistible, lorsqu'elle déchaîne toute sa violence : ceux qui lui cèdent, elle les traite avec douceur ; mais quand elle rencontre un cœur fier et rebelle, avec quelle hauteur pensez-vous qu'elle s'en empare et se plaise à l'humilier? Vénus s'élance dans les airs, elle pénètre au sein des mers ; tout est né d'elle ; c'est elle qui fait germer et qui nourrit l'amour, auquel tous sur la terre nous devons la vie. Tous ceux qui possèdent les écrits des anciens, ceux qui jouissent du commerce des Muses, savent comment Jupiter fut épris de Sémélé ; ils savent que la brillante Aurore enleva parmi les dieux Céphale, par amour pour lui. Cependant ces divinités habitent toujours le ciel, et ne se dérobent pas aux regards des autres dieux ; elles se résignent sans doute à la destinée qui les a vaincues : et toi, tu ne céderais pas à la tienne? Il fallait que ton père te mit au monde à certaines conditions, et sous l'empire d'autres dieux, si tu ne te résignes pas à ces lois. Combien crois-tu qu'il y ait d'époux sensés qui voient leur couche souillée, et feignent de ne pas voir? combien est-il de pères qui favorisent les amours de leurs enfants coupables? car l'habileté parmi les hommes consiste à cacher le mal. Les mortels ne doivent pas chercher dans leur vie une perfection trop rigide ; on ne prend pas non plus la peine de décorer le toit d'un vaste édifice. Dans l'abîme où tu es tombée, comment espérerais-tu échapper? Mais si, pour toi, le bien l'emporte sur le mal, malgré ta condition mortelle, tu dois t'estimer bien heureuse. Ainsi, ma chère fille, renonce à de mauvaises pensées, et cesse tes outrages ; car c'est un véritable outrage, que de vouloir s'élever au-dessus des dieux. Ose aimer, c'est une déesse qui l'a voulu ; et ce mal qui te dévore, fais tout pour t'en délivrer. Il est des enchantements et des paroles propres à calmer les fureurs amoureuses : on trouvera un remède pour ton mal. Certes, les hommes seraient bien lents dans leurs découvertes, si nous autres femmes ne trouvions pas de tels secrets.
LE CHOEUR.
Phèdre, les avis qu'elle te donne sont les plus utiles dans ton malheur présent ; mais tes sentiments sont ceux que j'approuve. Cependant cet éloge t'est plus odieux et plus pénible à entendre que les discours de ta nourrice.
PHÈDRE.
Voilà ce qui ruine les familles et les états les mieux constitués : ce sont les discours artificieux. Il faut dire, non ce qui flatte l'oreille, mais ce qui doit conduire à la gloire.
LA NOURRICE.
A quoi bon ce magnifique langage ? ce ne sont pas de belles paroles qu'il te faut, c'est l'homme que tu aimes. Il faut reconnaître au plus vite ceux qui s'expliquent directement sur ta passion. Si ta vie n'était livrée à de telles calamités, si tu n'étais une femme modeste, jamais, pour favoriser tes voluptés et tes désirs coupables, je ne t'encouragerais à cette démarche : mais maintenant il s'agit de sauver ta vie, et pour cela rien ne doit coûter.
PHÈDRE.
Ô exécrables conseils! Tais-toi, malheureuse, et ne répète pas des paroles qui me font rougir.
LA NOURRICE.
Elles font rougir, mais elles sont meilleures pour toi que ta vertu ; et la chose vaudra mieux , pourvu qu'elle te sauve, qu'un nom pour lequel tu es fière de mourir.
PHÈDRE.
Au nom des dieux (tes paroles sont flatteuses mais infâmes), ne va pas plus loin ! ne dis pas que je fais bien de soumettre mon cœur à l'amour. Si tu persistes à parer l'infamie, je tomberai dans l'abîme que je veux éviter.
LA NOURRICE.
S'il te semble ainsi, il fallait ne pas tomber en faute ; cependant, si les choses sont ce qu'elles sont, écoute-moi : ce sera le second service. Je possède un philtre propre à apaiser les fureurs de l'amour ; le souvenir vient de m'en revenir à l'esprit : sans t'induire à des actions honteuses, ni sans porter atteinte à ta raison, il fera cesser ton mal, pourvu que tu ne sois pas pusillanime. Mais il faut que je me procure quelque signe de celui que tu aimes, ou quelque parole, ou un morceau de ses vêtements, pour ne faire qu'un de deux cœurs.
PHÈDRE.
Ce philtre s'emploie-t-il comme breuvage, ou doit-on s'en oindre le corps?
LA NOURRICE.
Je ne sais : souffre qu'on te serve, ma fille, et n'exige pas qu'on t'instruise.
PHÈDRE.
Je crains que tu ne sois trop habile.
LA NOURRICE.
Tout est pour toi sujet d'alarmes. Que crains-tu encore?
PHÈDRE.
Que tu ne révèles quelque chose au fils de Thésée.
LA NOURRICE.
Sois tranquille, ma fille, et laisse-moi tout diriger. Toi seulement, puissante Vénus, viens à mon aide. Pour le reste de mes desseins, il suffira d'en faire part aux amis qui sont dans le palais.
-
Sénèque, Hippolyte.
ACTE QUATRIÈME. THÉSÉE, LE MESSAGER.
(Le messager) Ô triste et pénible condition de la servitude, qui m'oblige à remplir un si triste message!
(Thésée) Ne crains pas de m'annoncer les plus terribles malheurs: mon âme est depuis longtemps préparée aux coups de la fortune. (Le messager) Ma langue se refuse à ce récit déplorable. (Thésée) Parle; dis-moi quel nouveau malheur afflige ma maison. (Le messager) Hippolyte, hélas! une mort cruelle vous l'a ravi. (Thésée) Depuis longtemps je n'avais plus de fils. C'est d'un traître que les dieux me délivrent. Je veux savoir les détails de sa mort.
(Le messager) Dès qu'il fut sorti de la ville, comme un fugitif, marchant d'un pas égaré, il attelle à la hâte ses coursiers superbes, et ajuste le mors dans leurs bouches dociles. Il se parlait à lui-même, détestant sa patrie, et répétant souvent le nom de son père. Déjà sa main impatiente agitait les rênes flottantes; tout à coup nous voyons en pleine mer une vague s'enfler, et s'élever jusqu'aux nues. Aucun souffle cependant n'agitait les flots; le ciel était calme et serein:la mer paisible enfantait seule cette tempête. Jamais l'Auster n'en suscita d'aussi violente au détroit de Sicile: moins furieux sont les flots soulevés par le Corus dans la mer d'Ionie, quand ils battent les rochers gémissants, et couvrent le sommet de Leucate de leur écume blanchissante. Une montagne humide s'élève au-dessus de la mer, et s'élance vers la terre avec le monstre qu'elle porte dans son sein; car ce fléau terrible ne menace point les vaisseaux, il est destiné à la terre. Le flot s'avance lentement, et l'onde semble gémir sous une masse qui l'accable. Quelle terre, disions-nous, va tout à coup paraître sous le ciel? C'est une nouvelle Cyclade. Déjà elle dérobe à nos yeux les rochers consacrés au dieu d'Épidaure, ceux que le barbare Sciron a rendus si fameux, et cet étroit espace resserré par deux mers. Tandis que nous regardions ce prodige avec effroi, la mer mugit, et les rochers d'alentour lui répondent. Du sommet de cette montagne s'échappait par intervalle l'eau de la mer, qui retombait en rosée mêlée d'écume. Telle, au milieu de l'Océan, la vaste baleine rejette les flots qu'elle a engloutis. Enfin cette masse heurte le rivage, se brise, et vomit un monstre qui surpasse nos craintes. La mer entière s'élance sur le bord, et suit le monstre qu'elle a enfanté. L'épouvante a glacé nos cœurs. (Thésée) De quelle forme était ce monstre énorme? (Le messager) Taureau impétueux, son cou est azuré; une épaisse crinière se dresse sur son front verdoyant; ses oreilles sont droites et velues: ses cornes, de diverses couleurs, rappellent les taureaux qui paissent dans nos plaines, et ceux qui composent les troupeaux de Neptune. Ses yeux tantôt jettent des flammes, et tantôt brillent d'un bleu étincelant; ses muscles se gonflent affreusement sur son cou énorme; il ouvre en frémissant ses larges naseaux; une écume épaisse et verdâtre découle de sa poitrine et de son fanon; une teinte rouge est répandue le long de ses flancs; enfin, par un assemblage monstrueux, le reste de son corps est écaillé, et se déroule en replis tortueux. Tel est cet habitant des mers lointaines, qui engloutit et rejette les vaisseaux. La terre voit ce monstre avec horreur; les troupeaux effrayés se dispersent; le pâtre abandonne ses génisses; les animaux sauvages quittent leurs retraites, et les chasseurs eux-mêmes sont glacés d'épouvante. Le seul Hippolyte, inaccessible à la peur, arrête ses coursiers d'une main ferme, et, d'une voix qui leur est connue, s'efforce de les rassurer. Une partie de la route d'Argos est percée entre de hautes collines, et voisine du rivage de la mer. C'est là que le monstre s'anime au combat et aiguise sa rage. Dès qu'il a pris courage et médité son attaque, il s'élance par bonds impétueux, et, touchant à peine la terre dans sa course rapide, il se jette au-devant des chevaux effrayés. Votre fils, sans changer de visage, s'apprête à le repousser, et, d'un air menaçant et d'une voix terrible: "Ce monstre, s'écrie-t-il, ne saurait abattre mon courage; mon père m'a instruit à terrasser les taureaux". Mais les chevaux, ne connaissant plus le frein, entraînent le char, et, quittant le chemin battu, n'écoutent plus que la frayeur qui les précipite à travers les rochers. Comme un pilote qui, malgré la tempête, dirige son navire et l'empêche de présenter le flanc aux vagues, tel Hippolyte gouverne encore ses chevaux emportés. Tantôt il tire à lui les rênes, tantôt il les frappe à coups redoublés. Mais le monstre, s'attachant à ses pas, bondit tantôt à côté du char, tantôt devant les coursiers, et partout redouble leur terreur. Enfin il leur ferme le passage et s'arrête devant eux, leur présentant sa gueule effroyable. Les coursiers épouvantés, et sourds à la voix de leur maître, cherchent à se dégager des traits; ils se cabrent, et renversent le char. Le jeune prince tombe embarrassé dans les rênes, et le visage contre terre. Plus il se débat, plus il resserre les liens funestes qui le retiennent. Les chevaux se sentent libres, et leur fougue désordonnée emporte le char vide partout où la peur les conduit. Tels les chevaux du Soleil ne reconnaissant plus la main qui les guidait d'ordinaire, et indignés qu'un mortel portât dans les airs le flambeau du jour, abandonnèrent leur route, précipitant du ciel le téméraire Phaéton. La plage est rougie du sang du malheureux Hippolyte; sa tête se brise en heurtant les rochers. Les ronces arrachent ses cheveux, les pierres meurtrissent son visage; et ces traits délicats, dont la beauté lui fut fatale, sont déchirés par mille blessures. Mais tandis que le char rapide emporte çà et là cet infortuné, un tronc à demi brûlé, et qui s'élevait au-dessus dé la terre, se trouve sur son passage, et l'arrête. Ce coup affreux retient un moment le char; mais les chevaux forcent l'obstacle en déchirant leur maître, qui respirait encore. Les ronces achèvent de le mettre en pièces. Il n'est pas un buisson, pas un tronc qui ne porte quelque lambeau de son corps. Ses compagnons éperdus courent à travers la plaine, et suivent la route sanglante que le char a marquée. Ses chiens même cherchent en gémissant les traces de leur maître. Hélas! nos soins n'ont pu rassembler encore tous les restes de votre fils. Voilà ce prince naguère si beau! voilà celui qui partageait glorieusement le trône de son père, et qui devait lui succéder un jour! Ce matin il brillait comme un astre; maintenant ses membres épars sont ramassés pour le bûcher.
(Thésée) Ô Nature! force impérieuse du sang! que tes droits sont puissants sur le coeur d'un père! C'est en vain qu'on cherche à étouffer ta voix. J'ai voulu la mort du coupable, et je déplore sa perte.
(Le messager) Il est étrange qu'on pleure une mort qu'on a souhaitée.
Thésée) Je regarde comme le plus grand des maux l'accomplissement d'un voeu barbare, (Le messager) Si vous haïssez toujours votre fils, pourquoi verser des pleurs? (Thésée). Ce qui m'afflige, ce n'est pas de l'avoir perdu, c'est d'avoir causé sa mort.
LE CHOEUR. À quelles vicissitudes est exposé le destin des grands! Les petits n'ont pas à craindre ces changements terribles: un dieu mesure à leur faiblesse les atteintes du sort. C'est au sein de l'obscurité qu'on trouve la paix; c'est dans les chaumières qu'on vieillit sans alarmes.
-
Ovide, Les Métamorphoses, « Myrrha ».
La passion incestueuse de Myrrha pour son père Cinyras (livre X, 298-367)
De cette Paphos naquit l’illustre Cinyras, qui aurait pu compter, parmi les gens heureux, s’il était resté sans descendance.
Je vais chanter un crime affreux. Jeunes filles, et vous, pères, éloignez-vous et ne m’écoutez pas; ou si mes vers ont pour vous quelques charmes, doutez du fait que je vais raconter : ou, si vous le croyez, croyez aussi et gravez dans vos cœurs le châtiment qui l’a suivi. Je félicite les peuples de la Thrace, et ce ciel, et ma patrie, d’être éloignés des climats qui furent témoins d’un forfait aussi odieux. Que l’heureuse Arabie soit féconde en amome; que l’encens, des parfums précieux, des plantes rares, des fleurs odoriférantes, croissent dans son sein : elle voit naître aussi la myrrhe, et l’arbre qui la porte est trop cher acheté par le crime qui l’a produit.
Myrrha ! l’Amour même se défend de t’avoir blessée de ses traits, d’avoir allumé de son flambeau tes feux criminels. Ce fut une des Furies, armée de sa torche infernale, qui souffla sur toi les poisons dont ses affreux serpents étaient gonflés. La haine pour un père est un crime dans ses enfants; mais l’amour que tu sens est cent fois plus détestable. Tous les princes de l’Orient se disputent et ton cœur et ta main. Parmi tous ces amants, choisis un époux : n’excepte que celui qui t’a donné le jour.
Cependant Myrrha connaît le trouble de son cœur, la honte et l’horreur de sa flamme. “Quelle fureur m’entraîne, dit-elle, et qu’est-ce que je veux ? Ô dieux immortels ! ô piété filiale ! droits sacrés du sang ! étouffez mon amour, et prévenez un si grand crime, si c’est un crime en effet. Mais la nature ne paraît pas condamner mon penchant. Les animaux s’unissent indistinctement et sans choix. Le taureau, le cheval, le bélier fécondent le sein qui les a nourris. L’oiseau couve avec sa mère dans le nid qui fut son berceau. Ah ! l’homme est moins heureux. Il s’est enchaîné par des lois cruelles qui condamnent ce que permet la nature. On dit pourtant qu’il existe des nations où le père et la fille, où le fils et la mère, unis par l’hymen, voient leur amour croître par un double lien.
“Pourquoi chez ces peuples heureux n’ai-je reçu le jour, loin de la terre où je suis née, et dont les lois condamnent mon amour ? Mais pourquoi me retracer ces objets ? Fuyez, vains désirs, faux espoir ! Cinyras mérite mon amour, mais je ne dois aimer Cinyras que comme on aime un père. Ainsi donc, si je n’étais sa fille, je pourrais aspirer à lui plaire ! Ainsi si j’étais moins à lui, il serait plus à moi ! Le lien qui nous unit s’oppose à mon bonheur. Étrangère à Cinyras, ah ! je serais plus heureuse.
“Fuyons de ces lieux. Ce n’est qu’en abandonnant ma patrie que je pourrai triompher d’un penchant criminel. Mais, hélas ! une erreur funeste me retient et m’arrête. Que du moins je puisse voir Cinyras, me placer à ses côtés; que je puisse lui parler, recevoir ses baisers et les lui rendre, s’il ne m’est permis d’espérer rien de plus. Eh ! que peux-tu, fille impie, prétendre plus encore ? Veux-tu confondre ensemble tous les noms et tous les droits; être la rivale de ta mère, et la fille de ton époux, et la sœur de ton fils, et la mère de ton frère? Ne crains-tu pas les sombres déités, aux cheveux de serpents, qui, à la lueur de leurs torches sanglantes, voient et épouvantent le crime dans le cœur des mortels. Ah ! tandis que ton corps est pur encore du crime, garde-toi d’en souiller ton esprit. Ne cherche point à violer les droits sacrés de la nature. Quand ton père partagerait ton funeste délire, ce délire trouve en lui-même sa condamnation. Mais Cinyras a trop de vertu. Il connaît et respecte les droits du sang. Malheureuse ! ah ! pourquoi ne brûle-t-il pas des mêmes feux que moi” !
Ainsi parlait Myrrha. Cependant Cinyras, hésitant sur le choix qu’il doit faire dans le grand nombre d’illustres amants qui recherchent la main de sa fille, l’interroge elle-même, lui nomme ces amants, et consulte son cœur. Elle se tait, elle rougit en regardant son père, et ses yeux enflammés se remplissent de larmes. Cinyras croit que ces larmes et ce silence expriment la pudeur et l’embarras d’une vierge timide. Il lui défend de s’affliger, il essuie ses pleurs, il l’embrasse; et ce baiser paternel est pour elle plein de charmes. Il l’interroge encore sur le choix qu’elle doit faire : “Puisse mon époux, dit-elle, être semblable à vous” ! Cinyras loue cette réponse, qu’il est loin de comprendre : “Ô ma fille ! s’écrie-t-il, conserve toujours pour ton père la même piété” ! À ce saint nom, Myrrha baisse les yeux et reconnaît son crime.
Myrrha et sa nourrice (livre X, 368-430)
Le char de la Nuit roulait dans l’ombre et le silence. Le sommeil suspendait les travaux et les peines des mortels. La fille de Cinyras veille, et brûle d’un feu qu’elle ne peut dompter. En proie à cette passion fatale, tantôt elle désespère, et tantôt elle veut tout oser. Elle rougit, elle désire, et ne sait à quel parti s’arrêter. Comme, près de sa racine, profondément par la hache entamé, l’arbre qui n’attend plus qu’un dernier coup, gémit, chancelle, ne sait de quel côté son poids va l’entraîner, et de tous côtés fait craindre son immense ruine: telle, profondément blessée, Myrrha sent s’égarer son esprit agité de mouvements divers. Elle forme tantôt un dessein, tantôt un autre : enfin, elle ne voit plus de repos pour elle et de remède a son mal que dans la mort. Elle se lève, elle veut de ses propres mains terminer sa triste destinée; et soudain à une poutre attachant sa ceinture : “Adieu, dit-elle, cher Cinyras ! Puissiez-vous ne pas ignorer la cause de ma mort” ! Elle dit, et déjà elle attachait à son cou le funeste tissu.
Mais des murmures confus ont frappé les oreilles de sa nourrice, qui repose près de son appartement. La vieille se lève, ouvre la porte, voit les funèbres apprêts, s’écrie, meurtrit son sein, arrache et déchire la ceinture fatale. Elle pleure ensuite, embrasse Myrrha, et veut enfin connaître la cause de son désespoir.
Myrrha se tait, immobile, et les yeux baissés, accusant en secret le zèle pieux qui vient retarder son trépas. La nourrice redouble ses prières, et découvrant sa tête blanchie par les ans, son sein aride et flétri, elle la conjure par les soins qu’elle prit d’elle au berceau, par ce sein dont le lait fut son premier aliment, de confier son secret à son amour, à sa foi. Myrrha soupire, se détourne, et gémit. La nourrice la presse encore de rompre le silence : “Parlez, dit-elle, et souffrez que je vous sois utile. Ma vieillesse, encore active, ne peut m’empêcher de vous servir. Si l’amour est le mal qui fait votre tourment, je trouverai dans les plantes et dans des paroles magiques un remède certain. Si par quelque maléfice vos esprits sont troublés, j’emploierai pour vous guérir les charmes les plus puissants. Si la colère des dieux s’est appesantie sur vous, on peut les apaiser par des sacrifices. Que dois-je craindre encore, et qui peut vous affliger ? Tout vous rit; la fortune de votre maison est à l’abri des revers. Votre mère vit, ainsi que votre père heureux de votre amour “.
Au nom de son père, Myrrha pousse un profond soupir. La nourrice ne soupçonne encore aucun crime; mais elle attribue ce soupir à l’amour. Elle insiste, elle conjure Myrrha de rompre le silence. Elle la prend en pleurant sur ses genoux chancelants; elle la serre dans ses bras par l’âge affaiblis.
“Je le vois, dit-elle, vous aimez. Mes services vous seront utiles; bannissez toute crainte. Je saurai vous cacher de votre père”. À ces mots, furieuse, égarée, Myrrha s’arrache des bras de sa nourrice, et pressant son lit de son front : “Éloigne-toi, s’écrie-t-elle, et respecte la honte qui m’accable. Éloigne-toi, ou cesse de me demander la cause de ma douleur ! Ce que tu veux savoir est un crime odieux”.
La nourrice frémit, et lui tendant des bras de vieillesse et de crainte tremblants, elle se prosterne suppliante à ses pieds. Elle emploie tour à tour la prière et la crainte. Elle menace de révéler ce qu’elle a vu, le lien fatal à la poutre attaché; elle promet au contraire de servir l’amour dont le secret lui sera confié.
Myrrha lève la tête, elle baigne de ses pleurs le sein de sa nourrice, elle veut parler, et sa voix se refuse au pénible aveu qu’elle va faire. Enfin, couvrant son front de sa robe, elle dit : “Ô trop heureuse ma mère, épouse de Cinyras” ! Elle s’arrête, et gémit. Mais la nourrice n’a que trop entendu cet aveu commencé. Tous ses membres frémissent d’horreur, et ses cheveux blanchis se hérissent sur sa tête. Elle épuise tous les raisonnements pour vaincre une passion si détestable. Myrrha reconnaît la vérité, la sagesse de ses avis; mais elle est sûre de mourir, si elle renonce à son amour : “Vivez donc, dit enfin la nourrice ! Oui, vous posséderez… ” Elle n’ose ajouter votre père; elle se tait, et confirme sa promesse en attestant les dieux.
L’occasion et l’accomplissement de l’union incestueuse (livre X, 431-475)
C’était le temps où les femmes, en longs habits de lin, célébraient les fêtes de Cérès, et offraient à la déesse les prémices des fruits et les premiers épis. Pendant les neuf jours de ces solennités, elles devaient s’abstenir de la couche nuptiale. Avec elles Cenchréis, épouse de Cinyras, assistait à la célébration des mystères sacrés.
Tandis que la reine abandonnait ainsi le lit de son époux, l’artificieuse nourrice, trouvant le roi échauffé des vapeurs du vin, lui peint sous un nom supposé une amante réelle, et vante ses attraits. Interrogée sur son âge : “C’est, dit-elle, celui de Myrrha”. Elle reçoit l’ordre de l’amener. Elle rejoint Myrrha : “Réjouissez-vous, ma fille, s’écrie-t-elle, la victoire est à nous” ! Mais une joie parfaite ne remplit point le cœur de la triste Myrrha. Il est troublé de sinistres présages, et cependant elle se réjouit : tant sont grands le désordre et la confusion de ses sens !
La nuit avait ramené le silence et les ombres. Le Bouvier roulait obliquement son char entre les étoiles de l’Ourse. Myrrha marche à son crime. La lune, au front d’argent, la voit, se, détourne, et s’enfuit. De sombres nuages voilent les astres, et la nuit a caché tous ses feux. Icare, le premier, tu couvris ton visage, ainsi que ta fille Ërigone, qu’auprès de toi plaça sa piété.
Trois fois en marchant le pied de Myrrha tremble et chancelle. Trois fois un hibou funèbre semble l’avertir et la rappeler par ses cris. Sans écouter ce sinistre présage, elle avance et poursuit. L’obscurité profonde l’encourage. Ce qui lui reste de pudeur dans les ténèbres s’évanouit. D’une main, elle s’appuie sur sa nourrice; de l’autre, qui se meut en avant dans l’ombre, elle interroge le chemin. Elle touche enfin la porte de l’appartement où repose son père : elle l’ouvre, elle entre, elle frémit. Ses genoux tremblants fléchissent : son sang s’arrête dans ses veines; elle pâlit; son courage l’abandonne. Plus elle est près du crime, plus le crime lui fait horreur. Elle se repent d’avoir trop osé. Elle voudrait pouvoir, sans être reconnue, revenir sur ses pas; mais, tandis qu’elle hésite, la vieille l’entraîne par le bras, et, la conduisant près du lit de Cinyras : “Je vous la livre, elle est à vous”, dit-elle, et sa main les unit.
Cinyras reçoit ainsi sa fille dans son lit incestueux. Il attribue la frayeur qui l’agite aux combats de la pudeur. Elle tremblait : il la rassure. Peut-être aussi, par un nom à son âge permis, il l’appelle : ma fille; elle répond : mon père ! afin que rien, pas même ces noms sacrés, ne manque à leur forfait.
Myrrha sort du lit de son père, portant dans son flanc le fruit d’un inceste odieux. La nuit du lendemain voit renouveler son crime; plusieurs autres nuits en sont les complices et les témoins. Enfin Cinyras veut voir cette amante inconnue. Un flambeau qu’il tient lui montre et sa fille et son crime. Saisi d’horreur, la parole expire sur ses lèvres; soudain il saisit son épée suspendue auprès de son lit. Le fer brille.
Fuite et métamorphose de Myrrhra – Naissance d’Adonis (livre X, 476-518)
Myrrha fuit épouvantée. Les ténèbres la protègent; elle échappe à la mort. Elle erre dans les campagnes; elle traverse celles de l’Arabie fertile en palmiers, celles de Panchaïe. Elle voit neuf fois croître et décroître le disque de Phébé. Enfin, succombant sous le poids de son sein et de ses longues courses, elle s’arrête aux champs de la Sabée. Incertaine dans les vœux qu’elle a formés, lasse de vivre, et craignant la mort, elle s’écrie : “Ô dieux ! si vous êtes touchés de l’aveu des fautes des mortels et de leur repentir, je reconnais avoir mérité ma peine, je me soumets au châtiment que m’a réservé votre colère. Mais, afin que ma vue ne souille pas les yeux des humains, si je reste sur la terre; ni les regards des ombres, si je descends dans leur triste séjour, sauvez-moi de la vie, sauvez-moi de la mort ; et, changeant ma forme et ma figure, faites qu’en même temps je sois et ne sois plus !”
Le coupable qui se repent trouve toujours quelque divinité propice. Du moins les derniers vœux de Myrrha furent exaucés par des dieux bienfaisants. Elle parlait encore, et ses pieds s’enfoncent dans la terre; des racines en sortent, serpentent, affermissent son corps. Nouvel arbre, ses os en font la force : leur moelle est moelle encore; la sève monte et circule dans les canaux du sang. Ses bras s’étendent en longues branches, ses doigts en légers rameaux; sa peau se durcit en écorce. Déjà l’arbre pressait son flanc, couvrait son sein, et, croissant par degrés, s’élevait au-dessus de ses épaules. Myrrha, impatiente, penche son cou, plonge sa tête dans l’écorce, et y cache sa douleur.
Mais, quoique en perdant sa forme, elle ait aussi perdu le sentiment, elle pleure encore; un parfum précieux distille de l’arbre qui porte son nom, et le rendra célèbre jusque dans les siècles à venir.
Cependant le fruit d’un coupable amour avait crû, et cherchait à s’ouvrir le tronc qui renferme sa mère. Le tronc s’enfle ; Myrrha sent les douleurs de l’enfantement; mais elle n’a plus de voix pour les exprimer, pour appeler Lucine à son secours. L’arbre en travail se recourbe, gémit, et des larmes plus abondantes semblent couler de son écorce.
La compatissante Lucine approche des rameaux; elle y porte les mains, et prononce des mots puissants et favorables. L’arbre se fend, l’écorce s’ouvre, il en sort un enfant. À ses premiers cris, les Naïades accourent, le couchent sur l’herbe molle, arrosent son corps, et l’embaument des pleurs de sa mère. Il pourrait plaire même aux yeux de l’Envie. Il est semblable à ces Amours que l’art peint nus sur la toile animée ; et si l’on veut que l’œil trompé s’y méprenne, qu’on donne un carquois à Adonis, ou qu’on l’ôte aux Amours.
-
Ovide, Les Héroïdes, Epître4, « Phèdre à Hippolyte ».
PHEDRE A HIPPOLYTE La jeune fille que la Crète a vue naître envoie au fils de l'Amazone le salut qui lui manquera à elle-même, si tu ne le lui donnes. Quelle qu'elle soit, lis ma lettre en entier. Quel mal crains-tu de cette lecture ? Peut-être même trouveras-tu quelque charme à la faire. A l'aide de ces signes, un secret parcourt et la terre et les mers. L'ennemi examine la lettre qu'il a reçue de son ennemi. Trois fois je résolus de m'entretenir avec toi, trois fois s'arrêta ma langue impuissante, trois fois le son vint expirer sur mes lèvres. La pudeur doit, autant qu'il est possible, se mêler à l'amour. Ce que je n'osai pas dire, Amour m'a ordonné de l'écrire, et les ordres qu'Amour donne, il est dangereux de les dédaigner. Il règne, il étend ses droits sur les dieux souverains. C'est lui qui, me voyant hésiter d'abord, m'a dit : «Ecris ; ce coeur de fer, se laissant vaincre, reconnaîtra des lois». Qu'il me protège, et comme il embrase mes veines d'un feu dévorant, qu'il rende aussi ton coeur favorable à mes voeux.
Ne crois pas que ce soit par corruption de coeur que je romps les liens qui m'enchaînent : nulle faute, et tu peux t'en enquérir, n'a terni ma renommée. L'amour exerce d'autant plus d'empire qu'on le connaît plus tard : je brûle intérieurement, je brûle, et une blessure cruelle fait saigner mon coeur. Comme les jeunes taureaux se sentent blessés par le premier joug qu'on leur impose, comme un poulain tiré du troupeau ne peut d'abord supporter le frein, ainsi un coeur novice subit difficilement et avec peine les premières atteintes de l'amour ; et le mien succombe sous ce fardeau qui l'accable. Le crime devient un art, lorsqu'il est appris dès un âge tendre ; celle qui aime tard aime avec plus de violence. Tu raviras les prémices d'un honneur resté intact, et la faute entre nous deux sera égale. C'est quelque chose que de cueillir à pleines mains des fruits dans un verger ; que de détacher d'un doigt délicat la rose qui vient d'éclore. Si toutefois cette pureté native d'un coeur qui ne connut jamais le crime doit être souillée d'une tache inaccoutumée, je suis heureuse de brûler d'un feu digne de moi ; je n'ai pas fait un choix honteux, pire que l'adultère. Oui, si Junon m'offrait le dieu, son frère et son époux, il me semble qu'à Jupiter je préférerais Hippolyte.
Déjà même, pourras-tu le croire ? je suis entraînée vers un art jusqu'alors inconnu pour moi ; je veux, d'une course rapide, suivre aussi les bêtes fauves ; déjà ma première divinité est celle de Délos, dont la parure est un arc recourbé ; tes goûts sont devenus ma loi. Je voudrais parcourir l'étendue des forêts, presser le cerf dans les toiles, exciter, sur la cime des monts, l'ardeur d'une meute ; je voudrais, d'un bras vigoureux, lancer le javelot tremblant, ou reposer mon corps sur un frais gazon. Souvent je me plais à diriger un char léger à travers la poussière, et à faire sentir le frein à la bouche d'un coursier docile. Tantôt je m'élance, semblable à la prêtresse de Bacchus qu'agitent les fureurs de ce dieu, semblable à celles qui, sur le mont Ida, font résonner les tambourins, à celles à qui les Dryades, ces demi-déesses, et les Faunes à la double corne, ont soufflé un enthousiasme inconnu. Car on me redit tout, lorsque mon transport est calmé ; moi seule je connais l'amour secret qui me brûle.
Peut-être me faut-il éprouver cet amour fatalement attaché à ma race, et Vénus doit-elle lever ce tribut sur ma famille entière. Jupiter (et c'est là l'origine première de notre maison), Jupiter aima Europe ; un taureau cachait le dieu sous sa forme. Pasiphaë, ma mère, livrée à un taureau abusé, rejeta de ses flancs son crime et son fardeau. Le fils ingrat d'Egée, en suivant le fil libérateur que tenait la main de ma soeur, parcourut sans danger les détours du Labyrinthe. Moi-même à mon tour, afin que l'on me reconnaisse pour la fille de Minos, je subis la dernière les lois communes à ma famille. Le destin l'a encore voulu, deux femmes ont trouvé des chaînes dans la même maison : ta beauté m'a séduite ; ma soeur s'est éprise de ton père. Thésée et son fils ont ravi les deux soeurs : marquez par un double trophée ce triomphe sur notre maison.
Au temps où tu vins à Eleusis la ville de Cérès, j'aurais voulu que la terre de Gnos eût pu me retenir. Je t'aimais déjà ; tu me plus alors bien davantage. Un amour brûlant pénétra jusque dans la moelle de mes os. Ton vêtement était d'une éclatante blancheur ; des fleurs entouraient ta chevelure ; une chaste rougeur colorait tes joues d'un noble incarnat. Ce visage, que les autres femmes appellent dur et farouche, n'était point dur au jugement de Phèdre ; il était mâle. Loin de moi ces jeunes gens parés comme une femme : une beauté virile n'aime que de modestes ajustements. Cette fierté même, ces cheveux flottants sans art et une légère poussière répandue sur ton front, tout cela sied bien à sa noblesse. Soit que tu rendes flexible l'encolure rebelle d'un coursier frémissant, j'admire tes pieds qui se rapprochent en un cercle étroit ; soit que, d'un bras nerveux, tu brandisses un pesant javelot, la vigueur qu'il déploie attire tous mes regards. J'aime encore à te voir la main armée d'épieux de cornouiller garnie d'un large fer : tout, oui, tout ce que tu fais charme mes yeux.
Laisse dans les forêts ta rudesse sauvage ; ma mort ne peut pas t'honorer. Que te sert de te livrer aux exercices de la légère Diane, si tu ravis ses droits à Vénus ? Ce qui se fait sans alternative de repos ne peut durer longtemps ; c'est le repos qui répare les forces et délasse les membres fatigués. L'arc (et règle-toi sur les armes de la déesse objet de ton culte), l'arc que tu ne cesserais jamais de tendre deviendrait lâche. Céphale était fameux dans les forêts, et sa main avait jonché de bêtes l'herbe qui les tapisse ; il sut cependant se prêter à l'amour de l'Aurore ; pour le visiter, la sage déesse quittait son vieil époux. Souvent, sous les yeuses, le premier gazon qui s'offrait, fut foulé par Vénus et par le fils de Cinyra, étendus l'un près de l'autre. Le fils d'Oenéus brûla pour Atalante du mont Ménale ; et celle-ci a pour gage d'amour la dépouille d'une bête fauve.
Que l'on nous compte bientôt aussi parmi cette foule heureuse : si tu dédaignes Vénus, tes bois restent sauvages. Moi-même je serai ta compagne ; je ne reculerai ni devant les roches caverneuses ni devant la dent oblique du sanglier redoutable. Deux mers entourent de leurs flots un isthme qu'elles assiègent ; un étroit défilé entend leurs doubles mugissements. C'est là qu'avec toi j'habiterai Trézène, royaume de Pithée : ces lieux me sont déjà plus chers que ma patrie.
Le héros, fils de Neptune, est maintenant absent, et il le sera longtemps : il est retenu dans le pays de son cher Pirithoüs. Thésée, nous n'en pouvons douter, préfère Pirithoüs à Phèdre, Pirithoüs à toi-même. Ce n'est pas le seul affront qui nous vienne de lui : nous en avons reçu tous deux de bien graves blessures. Sa massue à trois noeuds brisa les os de mon frère, et les dispersa sur le sol ; ma soeur fut laissée par lui en proie aux bêtes féroces. Celle que son courage éleva au premier rang parmi les filles qui portent la hache, t'a enfanté, toi qui héritas de la valeur de ta mère. Si tu veux savoir où elle est, Thésée lui traversa le flanc de son épée : un tel gage d'amour ne put mettre ta mère à l'abri de ses coups. Elle ne fut pas même son épouse ; le flambeau nuptial ne s'alluma point pour elle. Pourquoi ? sinon pour que tu fusses, comme fils illégitime, exclu du trône paternel ? Il t'associa les frères que je t'ai donnés ; et le sang qu'ils ont, ce n'est pas à moi qu'ils le doivent, mais à lui. Oh ! puisqu'il devait t'être funeste, à toi le plus beau des mortels, pourquoi ce sein n'a-t-il pas été déchiré au milieu des efforts de l'enfantement ? Va, maintenant, révère la couche d'un père si digne qu'on la lui garde pure, une couche qu'il fuit, qu'il abdique par de coupables actions.
Que l'union d'une belle-mère avec son beau-fils n'offre pas à ton esprit les terreurs qu'inspirent de vains préjugés. Ce scrupule suranné, qui devait disparaître dans les âges suivants, appartenait à celui qui vit Saturne gouverner son rustique royaume. Jupiter a légitimé tout ce qui peut plaire ; et l'hymen de la soeur avec le frère rend tout licite. L'alliance forme une chaîne indissoluble de parenté, lorsque à ces noeuds, Vénus elle-même a ajouté les siens. Il ne sera pas difficile de celer le mystère de notre amour. Que la parenté nous serve à le cacher : elle pourra couvrir notre faute de son nom. Si, nous tenant embrassés, nous sommes vus de quelqu'un, on nous en louera tous les deux : on dira que la belle-mère a de l'amitié pour son beau-fils. Tu n'auras pas à te faire ouvrir, pendant les ténèbres, la porte d'un mari redoutable ; tu n'auras pas de gardiens à tromper. Le même toit qui nous a réunis pourra nous réunir encore. Tu me donnais publiquement des baisers, tu m'en donneras publiquement. Avec moi tu seras en sûreté ; ta faute te méritera des éloges, fusses-tu même aperçu dans mon lit. Seulement bannis tout retard, et hâte le moment de cette union ; qu'à ce prix, Amour, maintenant cruel pour moi, t'épargne les tourments qu'il cause.
Je ne dédaigne pas de descendre à d'humbles prières. Hélas ! Où est maintenant le faste ? Où est l'orgueil de mes paroles ? J'avais résolu de combattre longtemps, et de ne pas céder à ma passion ; comme si l'amour ne triomphait pas de nos résolutions ! Vaincue et suppliante, je presse tes genoux de mes mains royales ; nul amant ne voit ce qu'exige la dignité. Je ne rougis plus, la pudeur une fois bannie renonce à son empire. Pardonne à ces aveux, et dompte un coeur cruel. Que me sert d'avoir pour père Minos qui tient des mers sous son sceptre ? Que me sert que la foudre s'échappe en serpentant des mains de mon aïeul ? Que mon grand-père, le front ceint de rayons étincelants, ramène sur son axe brillant la douce chaleur du jour ? La noblesse disparaît devant l'amour ; prends pitié de mes ancêtres ; et si tu ne veux m'épargner, épargne au moins les miens. J'ai pour dot la Crète, île de Jupiter. Que toute ma cour obéisse à mon Hippolyte.
Laisse fléchir ton orgueil. Ma mère a pu séduire un taureau : seras-tu plus cruel qu'un taureau farouche ? Par Vénus qui me possède, prends pitié de moi, je t'en conjure ; puisses-tu, à ce prix, n'aimer jamais qui pourrait dédaigner ton amour ! Qu'à ce prix la déesse des forêts te protège dans ses retraites solitaires ; que les bois touffus offrent à ton bras de nombreuses victimes ; qu'à ce prix les Satyres et les Pans, divinités des montagnes, te soient favorables, et que le sanglier tombe percé du fer de ta lance ; qu'à ce prix les Nymphes, quoiqu'on dise que tu hais leur sexe, présentent à ta soif brûlante une onde qui l'apaise ! C'est au milieu des larmes que je te fais ces prières ; tu lis jusqu'au bout ces paroles suppliantes ; et mes larmes, tu peux te les représenter.

Pour aller plus loin
Date de dernière mise à jour : 20/09/2019






 ème visiteur
ème visiteur