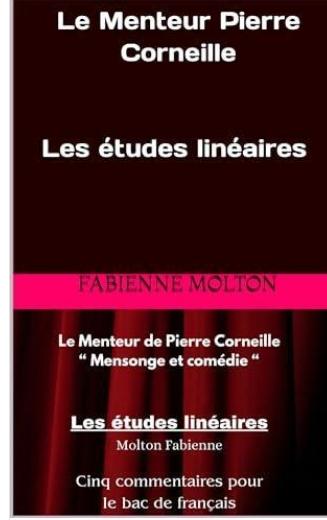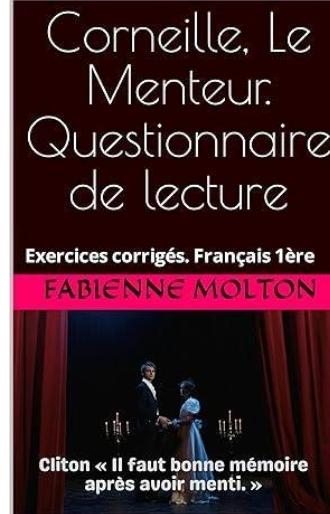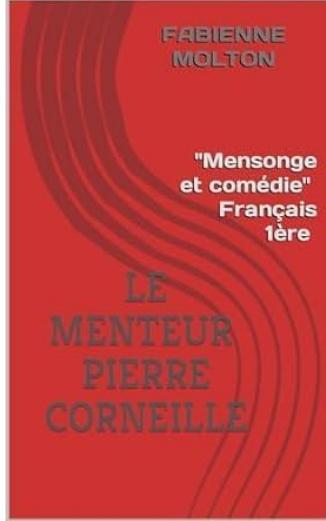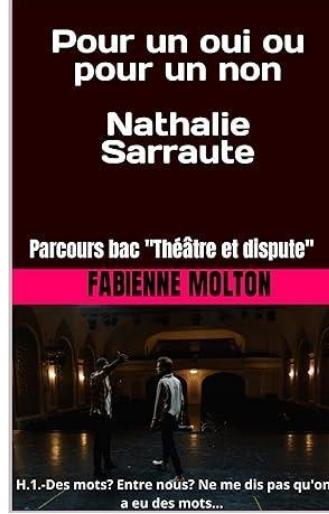Peut-on dire selon Rousseau que la fin de la guerre soit la destruction de l'Etat ennemi?

La guerre - sujet et corrigé d'un résumé et d'une dissertation - Rousseau, Du contrat social, I, IV - L'esclavage, la guerre, l'Etat
1) Sujet.
Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes.
Si un particulier, dit Grotius[1], peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d’un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d’un roi ? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d’explication ; mais tenons-nous-en à celui d’aliéner. Aliéner, c’est donner ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d’un autre ne se donne pas ; il se vend, tout au moins pour sa subsistance : mais un peuple, pourquoi se vend-il ? Bien loin qu’un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d’eux ; et, selon Rabelais[2], un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu’on prendra aussi leur bien ? Je ne vois pas ce qu’il leur reste à conserver.
On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile ; soit : mais qu’y gagnent-ils, si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne feraient leurs dissensions ? Qu’y gagnent-ils, si cette tranquillité même est une de leurs misères ? On vit tranquille aussi dans les cachots : en est-ce assez pour s’y trouver bien ? Les Grecs enfermés dans l’antre du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vînt d’être dévorés[3].
Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ; un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous ; la folie ne fait pas droit.
Quand chacun pourrait s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes et libres ; leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Avant qu’ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature, et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire fût légitime, qu’à chaque génération le peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejeter : mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire.
Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger ? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n’entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte ? Car, quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient et que, son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ?
Grotius et les autres[4] tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d’esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté ; convention d’autant plus légitime qu’elle tourne au profit de tous deux.
Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l’état de guerre. Par cela seul, que les hommes, vivant dans leur primitive indépendance, n’ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l’état de paix ni l’état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C’est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre ; et l’état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d’homme à homme ne peut exister ni dans l’état de nature, où il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social, où tout est sous l’autorité des lois.
Les combats particuliers, les duels, les rencontres, sont des actes qui ne constituent point un état ; et à l’égard des guerres privées, autorisées par les Établissements de Louis IX[5], roi de France, et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde, s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel et à toute bonne politie[6].
La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis que d’autres États, et non pas des hommes, attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport.
Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu’à leurs sujets. L’étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue, ou détient les sujets, sans déclarer la guerre au prince, n’est pas un ennemi, c’est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s’empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l’État ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l’on n’a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l’État sans tuer un seul de ses membres : or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes ; mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison.
À l’égard du droit de conquête, il n’a d’autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu’il n’a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n’a le droit de tuer l’ennemi que quand on ne peut le faire esclave ; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer : c’est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie, sur laquelle on n’a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d’esclavage, et le droit d’esclavage sur le droit de vie et de mort, n’est-il pas clair qu’on tombe dans le cercle vicieux ?
En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu’un esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis, n’est tenu à rien du tout envers son maître, qu’à lui obéir autant qu’il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce : au lieu de le tuer sans fruit, il l’a tué utilement. Loin donc qu’il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l’état de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur relation même en est l’effet ; et l’usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention ; soit : mais cette convention, loin de détruire l’état de guerre, en suppose la continuité.
Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage, et, droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement. Soit d’un homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé : « Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant qu’il me plaira. »
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762), livre I, chapitre IV De l’esclavage.
1. Résumez le texte en 250 mots (plus ou moins 10%). Vous indiquerez les sous totaux de 50 en 50 (50, 100, …) par un trait vertical et par le chiffre correspondant dans la marge. Vous indiquerez obligatoirement votre total exact au début votre résumé.
2. Dissertation.
En vous appuyant sur votre lecture des œuvres au programme, vous vous demanderez si on peut dire avec Rousseau que « la fin de la guerre » est « la destruction de l’État ennemi » ?
2) Analyse du texte et remarques.
Rousseau commence par énoncer le résultat des trois chapitres précédents, comme le montre le paratexte (= ensemble des éléments qui entourent le texte qui donnent des informations sur lui comme le titre, etc.), à savoir que le pouvoir politique, n’étant pas naturel, ne peut qu’être institué, autrement dit, il repose sur des conventions.
Il rapporte la thèse de Grotius selon laquelle un peuple peut, comme un particulier, se soumettre volontairement à un roi. L’idée est celle d’une convention au terme de laquelle l’un se soumet volontairement aux volontés de l’autre. Ainsi, la monarchie apparaît fondée.
Rousseau concède qu’un homme peut se vendre pour subsister pour en mieux déduire l’absurdité qu’un peuple le fasse puisque c’est lui qui nourrit le roi.
Il rapporte la thèse selon laquelle le tyran assure la paix civile, ce qui fonderait une sorte d’échange. Il la réfute en rapportant toutes les misères supportées par les peuples vivant sous la tyrannie : guerre, exploitations, etc. Il compare la vie sous la tyrannie à celle des compagnons d’Ulysse qui attendaient que le Cyclope les dévorât (épisode célèbre de l’Odyssée d’Homère).
Quant à un esclavage gratuit, il serait insensé et donc nul juridiquement.
Rousseau argumente ensuite en concédant que chaque membre d’un peuple pourrait se donner. Or, il refuse qu’un père puisse vendre ses enfants au tyran en ce sens qu’il n’en est pas propriétaire. Son pouvoir est limité à ce qui est requis pour l’éducation des enfants. Le peuple devrait donc à chaque génération se vendre, bref, il aurait le pouvoir. On comprend implicitement que c’est la république qui est le seul pouvoir légitime pour Rousseau puisqu’il réfute la fondation de la monarchie sur une convention.
Rousseau démontre positivement qu’il est illégitime qu’un homme renonce à sa liberté puisque c’est se rendre irresponsable moralement et c’est surtout un échange injuste puisqu’avec la liberté, le maître reçoit tout alors que l’esclave donne tout. On saisit alors mieux en quoi le premier argument du chapitre était une simple concession.
Rousseau rapporte la thèse de Grotius et d’autres selon laquelle c’est la guerre qui fonde le droit d’esclavage. En effet, le vaincu pour éviter la mort donne sa liberté et reçoit en échange la vie. C’est alors faire de la guerre le fondement du pouvoir monarchique. Cet argument ne peut être réfuté comme le premier par l’absurdité de l’échange. Il paraît plausible. Il fait écho à certaines théories dites de la guerre des races que Michel Foucault (1926-1984) a mises en lumière dans son cours au collège de France de 1976 : Il faut défendre la société. Ses théories voient dans la guerre l’origine du pouvoir politique, voire font de la politique, la continuation de la guerre par d’autres moyens selon une formule qui renverse celle de Clausewitz (De la guerre, I, 1, § 24). La thèse qu’examine Rousseau fait de la guerre l’origine d’un contrat ou d’une convention qui soumet l’un à l’autre, individu à individu ou peuple à individu.
Rousseau démontre d’abord que la guerre n’existe pas à l’état de nature car les hommes n’ont pas de relations qui leur permettraient d’être ennemis. De même, la guerre n’existe pas entre individus de sorte qu’aucun homme ne peut être l’ennemi au sens propre d’un autre homme. La guerre n’est qu’une relation entre États où il s’agit pour l’un et l’autre de se détruire comme États. Tout autre conflit n’est pas de l’ordre de la guerre mais éventuellement de l’ordre du brigandage.
C’est pourquoi la guerre ne peut conduire à détruire des hommes ou à leur prendre leurs biens. On ne peut donc fonder le droit de l’esclavage sur le droit de tuer puisqu’il est fondé sur l’impossibilité de faire de l’autre un esclave. Là encore l’échange est inique. En outre, il y a un diallèle (= cercle vicieux, selon un vocabulaire qui vient des sceptiques grecs) puisque le droit d’esclavage et le droit de vie et de mort se fondent réciproquement.
Rousseau, admettant par hypothèse le droit de tuer, montre alors que le vaincu reste dans l’état de guerre avec le vainqueur.
Il peut conclure que le droit d’esclavage est sans aucun sens puisqu’il repose sur l’idée d’un contrat où l’un a tous les droits et l’autre aucun.
3) Les idées essentielles.
1.Il n’y a de pouvoir politique qu’institué.
2.Grotius fonde le pouvoir politique sur la légitimité de l’esclavage.
3.Un peuple nourrit son roi alors que l’esclave peut passer pour être celui qui est nourri par son maître en échange de sa liberté.
4.Loin d’assurer la paix civile, le tyran augmente les misères du peuple comme un cannibale.
5.Un don gratuit serait insensé et juridiquement nul.
6.Un père ne pouvant vendre légitimement ses enfants, un tyran pour que son pouvoir soit légitime doit être choisi à chaque génération, ce qui supprimerait l’arbitraire.
7.La liberté de l’individu est inaliénable sans quoi il n’y a pas de morale et parce qu’échanger sa liberté contre autre chose c’est tout donner pour ne rien recevoir.
8.On a soutenu que la guerre fonde le droit d’esclavage car le vaincu se vend contre sa vie.
9.Or, la guerre n’est pas une relation entre des individus mais une relation entre des États. Les conflits entre les individus sont soit sporadiques, soit contraires au droit.
10.Ce n’est pas les individus qu’on peut tuer dans la guerre mais les États. Un tel droit de tuer pour fonder l’esclavage n’est qu’iniquité et diallèle.
11.Même si on avait le droit de réduire en esclavage un prisonnier de guerre, l’état de guerre ne cesserait jamais.
12.Le droit d’esclavage est un non sens qui donnerait tous les droits à l’un et tous les devoirs à l’autre.
4) Proposition de résumé.
250 mots
Le pouvoir politique doit donc être institué.
Grotius fonde le pouvoir politique sur la légitimité de l’esclavage. Or, un peuple nourrit son roi alors que l’esclave passe pour être nourri par son maître en échange de sa liberté. Loin d’assurer la paix civile, le tyran augmente les [50] misères du peuple tel un cannibale. Un don gratuit serait insensé, donc juridiquement nul.
Un père ne pouvant vendre légitimement ses enfants, le pouvoir d’un tyran ne serait légitime que s’il était choisi à chaque génération, ce qui supprimerait l’arbitraire.
La liberté de l’individu est inaliénable [100] sans quoi il n’y a pas de morale et parce qu’échanger sa liberté contre autre chose c’est tout donner et ne rien recevoir.
On a soutenu que la guerre fonde le droit d’esclavage car le vaincu se vend contre sa vie. Or, la guerre n’est [150] pas une relation entre des individus mais une relation entre des États hostiles. Les conflits entre les individus sont soit sporadiques, soit contraires au droit.
Ce n’est pas les individus qu’on peut tuer dans la guerre mais les États. Un tel droit de tuer pour fonder l’esclavage [200] n’est qu’iniquité et diallèle.
Même si on avait le droit de réduire en esclavage un prisonnier de guerre, l’état de guerre ne cesserait jamais.
Le droit d’esclavage est un non sens qui donnerait tous les droits à l’un et tous les devoirs à l’autre.
5) Dissertation.
Il est d’usage d’appeler guerre tout conflit quelque peu violent ou qui nous paraît tel. Il suffit même qu’il y ait un combat contre quelque chose pour qu’on parle de guerre. Pris en un sens aussi large, parler de guerre, c’est se donner la légitimité pour agir comme en temps de guerre.
Il paraît alors intéressant de prendre en compte la limitation à la notion de guerre que Rousseau a proposée dans le chapitre IV De l’esclavage du livre I Du Contrat Social. Le philosophe citoyen de Genève soutient en effet que « la fin de la guerre » est « la destruction de l’État ennemi ».
En désignant ainsi ce que la guerre vise, Rousseau la limite à plus d’un titre. Il exclut d’abord que la guerre oppose autre chose que des États, elle n’oppose pas des individus ou des hommes. Ensuite, l’objectif n’est pas de détruire des hommes mais de détruire l’État ennemi. Tuer des hommes désarmés, des civils, les réduire en esclavage, prendre leurs biens, tous ces actes n’ont donc rien pour lui à voir avec la guerre. Ils appartiennent bien plutôt aux brigandages.
Toutefois, une conception de la guerre qui la limite à la relation entre États, voire entre groupes sociaux qui luttent pour réaliser un État comme dans les cas de guerre civile, passe sous silence l’extrême violence qu’implique la guerre et qu’on ne retrouve pas nécessairement dans le brigandage.
On peut donc se demander si la fin de la guerre est bien la destruction de l’État ennemi ou bien si elle n’est pas l’expression de la violence pure ou bien si elle n’a pas une dimension politique multiforme.
En nous appuyant notamment sur la tragédie d’Eschyle, Les Perses, le roman de Barbusse, Le feu (Journal d’une escouade) et sur la philosophie de la guerre du livre I intitulé De la nature de la guerre du De la guerre de Carl Von Clausewitz, on examinera le bienfondé de la thèse de Rousseau. On envisagera le rôle de la violence pure dans la définition de la guerre avec de chercher les différentes fins politiques autres que la destruction de l’État ennemi susceptible de rendre compte du phénomène de la guerre dans sa différence avec les autres formes de conflits.
Il faut distinguer la guerre du simple usage de la force pour obtenir ce qu’on désire en ce sens qu’elle met aux prises des groupes qui s’opposent en tant que tels. C’est pourquoi la fin de la guerre est bien la destruction de l’État ennemi. Clausewitz soutient en effet que la guerre a pour but la destruction de l’ennemi (I, 1, § 2, p.20), mais qu’elle a une fin politique (I, 1, § 11, p.30). Or, cette fin est en dernière instance, la destruction de l’État ennemi, condition pour qu’il y ait paix. Par destruction, il ne faut pas entendre la pure et simple disparition de l’État ennemi, mais la fin de ce qui constitue l’État ennemi. Admettons qu’un État soit amputé d’une province pour prendre un exemple de Clausewitz. On doit considérer qu’il est détruit et change s’il est vrai que l’intégralité d’un territoire appartient à ce qui constitue l’État. C’est, malgré l’apparence, un autre État qui naît. Si on considère qu’il n’est pas détruit, la guerre est susceptible de reprendre à tout moment entre les États. Ainsi, la guerre entre les Grecs et les Perses n’est pas finie puisque la destruction de la liberté grecque a échoué et après Salamine, d’autres batailles comme Platées sont promises. Eschyle fait ainsi prévoir après coup l’événement par l’ombre du roi Darios (cf. v.816-817). Les allusions même à la ligue de Délos (v.879-886) montrent que l’état de guerre demeure entre Athènes et ses alliées d’une part et l’empire perse d’autre. Eschyle ne pouvait le savoir, mais on peut considérer que c’est Alexandre (355-322 av. J.-C.) qui a mis fin à cette guerre dans l’Antiquité en détruisant l’empire perse. Cette dimension de destruction de l’État ennemi apparaît comme la volonté des soldats qui font leur la volonté de faire disparaître le militarisme allemand et l’empire de Guillaume II. « Il n’y aura plus de guerre (…) quand il n’y aura plus d’Allemagne » s’exclame un soldat (XXIV L’aube, p.424). C’est donc bien l’État ennemi qui est ici visé. Et la fin de la guerre sur terre, au sens aussi de l’arrêt, est même ici liée à un État pensé comme essentiellement militariste – tout comme l’empire perse était pensé comme voué à la conquête, ce qui explique le succès de la pièce d’Eschyle à l’époque de la première guerre mondiale par la possibilité de transposition qu’elle permettait. On peut se permettre à l’inverse de considérer que l’accusation de militarisme est réversible. De l’invasion des États allemands par la révolution puis l’empire, au déclenchement de la guerre contre la Prusse à la revanche de 1914, comment ne pas penser la réversibilité. Reste que dans l’engagement, les soldats ont pour ennemis d’autres soldats et non des États.
La guerre oppose bien sur le terrain du combat des hommes. Ce sont certes des soldats. Ils sont formés pour combattre selon Clausewitz qui voit dans le soldat un « solide instrument de guerre » (I, 3 Du génie martial, p.72). Ils doivent prendre l’habitude du combat pour être efficace. En ce sens, la fin qui est la leur n’est pas la violence puisqu’il s’agit justement de les rendre apte à l’expérience du combat qui est singulière. Il faut les rendre violents mais telle que la guerre l’exige. En outre, ces hommes, lorsqu’ils ne sont pas de simples soldats de métiers, ils constituent la Cité. Les soldats des armées révolutionnaires puis de l’armée napoléonienne auxquels Clausewitz a été confronté faisaient l’État. Sans elle, l’État républicain aurait disparu plus vite qu’il ne l’a fait. Du côté des Grecs ou plutôt des Athéniens, les citoyens forment par eux-mêmes l’État. Le territoire compte. Mais ce sont les hommes qui constituent la cité, le rempart comme le dit le messager à la Reine lorsque dans une courte stichomythie, elle l’interroge sur les événements (cf. v.348-349). De même, les soldats qui constituent l’escouade en veulent aux boches. C’est ainsi que les désigne le caporal Bertrand (II Sous la terre81, p.). Mais, il invite ses soldats à faire leur devoir de soldats avant tout, à savoir en repoussant l’ennemi. Dès que les soldats le peuvent, ils retournent à l’arrière pour retrouver les leurs. L’ambivalence de leur engagement militaire montre justement que la guerre est l’affaire de l’État et que son objectif est bien de détruire l’État ennemi.
Toutefois, il y a une réalité des combats qui outrepasse le simple affrontement entre États. Et surtout, le déclenchement même de la guerre implique toujours tout autre chose qu’un différend entre États puisque la volonté de destruction de l’État ennemi est commune aux protagonistes. Dès lors, ne faut-il pas considérer que la guerre a bien la destruction de l’ennemi pour objectif, mais que cet ennemi est l’autre homme et non l’autre État ?
Clausewitz définit dès le début du livre I, au chapitre 1, 2, la guerre, comme la volonté de soumettre la volonté de l’autre à la nôtre. Et cette soumission est bien destruction de l’autre en ce sens que, si sa volonté devient la mienne, il n’est plus, s’il est vrai que c’est dans la volonté que se montre la réalité de la personne. Tuer ou réduire à l’esclavage, c’est en un sens la même chose. Il ne s’agit donc pas simplement de la destruction de l’État – qui n’est pas une fin à exclure – mais d’un ennemi bien réel, un autre homme ou un autre peuple : bref, un ennemi en chair et en os. Les Perses montrent des massacres strictement inutiles du point de vue la fin que suppose Rousseau, preuve que la violence dépasse toute fin dans la guerre. Ne voit-on pas les Athéniens achever leurs ennemis « comme des thons » (v.424), ce qui marque à la fois une forme d’humiliation de l’ennemi non seulement dans le fait mais encore dans le récit du messager qui ne pouvait pas ne pas réjouir les anciens combattants de Salamine qui assistaient au spectacle ou les anciens combattants d’Himère [bataille où les Grecs ont vaincu d’autres “barbares” : les carthaginois la même année que Salamine] lorsque la pièce fut représentée à Syracuse en Sicile en 471 av. J.-C. Les Perses eux-mêmes avaient détruit les temples à Athènes (cf. Les Perses, v.809-812) comme l’ombre du roi Darios leur en fait le reproche et massacrés d’ailleurs les habitants qui s’y trouvaient, ce que les spectateurs ne pouvaient manquer de savoir. Dire, dans les deux cas, qu’il s’agit de massacres inutiles c’est concevoir la guerre comme une relation réelle alors qu’elle est nécessairement aussi une relation personnelle puisque les soldats sont aussi des personnes et qui s’affrontent en tant que personnes. L’absurdité du massacre dans sa forme industrielle est clairement marquée par Barbusse dans son récit, notamment dans le chapitre Bombardement (cf. p.298-299) où le narrateur décrit le bombardement comme atteignant des cibles dont l’humanité paraît absente. Il s’adresse à eux en usant d’un registre qu’on peut qualifier de tragique. Mais cette violence n’est-elle pas au service de l’État ?
Si on en croit Clausewitz, ce qui caractérise le concept abstrait de guerre, c’est la montée aux extrêmes, à savoir la montée de la violence, celle de l’autre augmentant la mienne et réciproquement, celle de la volonté de désarmer l’adversaire et celle d’user du plus grand nombre de moyens et de la force de volonté la plus importante (cf. I, 1, §3, 4 et 5). La guerre est une série d’interactions. Et la première, celle de la montée de la violence puisque chacun des ennemis doit tenir compte de ce que l’autre fait sans quoi il est vaincu, comment s’explique-t-elle ? Comment cette violence est-elle possible ? D’où provient-elle ? Sa source ne peut qu’être le désir humain, non pas le désir pour quelque chose mais le désir de ce que l’autre désire et qui est désirable pour cette raison. C’est pourquoi on peut avec René Girard, dans Achever Clausewitz, considérer que telle est la structure du désir humain. Et c’est elle qui rend compte de l’essence de la guerre. Or, elle se réalise justement dans les guerres d’extermination que Clausewitz reconnaît (cf. I, 1, § 11, p.32). Il faut donc considérer que c’est l’État qui est au service de la violence et donc de la guerre et non l’inverse. Dans Les Perses, Eschyle fait justement de la conquête ce à quoi la structure impériale ennemie est vouée. Mais on peut tout autant dire que la cité d’Athènes, qui se défend, est bien aussi dans une logique de conquête, condition de la défense et donc qui implique que la fin de la guerre n’est possible que si les ennemis, les autres hommes et non l’État, sont définitivement détruits. Une telle montée en puissance de la violence qui met aux prises des hommes dépassés explique que Barbusse encadre son récit d’une phrase qui se répète sur le fait qu’une guerre, c’est une grande armée qui se suicide (p.51, p.423). Il touche peut-être par delà le “message” pacifiste et révolutionnaire à la racine de la guerre dans le désir humain qui, à la coopération, préfère la mort. Goya (1746-1828) a peint dans sa série de gravures Les désastres de la guerre (1810-1815) une extrême violence qui dépasse le simple engagement militaire.
Néanmoins, la guerre s’arrête toujours provisoirement. Et les scènes de liesse à l’annonce de la paix retrouvée montrent s’il était besoin que la guerre n’est pas la réalisation d’une quelconque nature humaine qui serait toujours et tout le temps vouée à la violence d’un désir incontrôlable. Si donc la guerre n’a pas seulement pour fin la destruction de l’État ennemi ni la pure violence et la destruction de l’ennemi comme autre homme, comment concevoir sa fin ?
La guerre engage un groupe dans sa réalité. Il doit donc y recourir pour un motif qui le concerne. Sans ce motif, la guerre ne se déclare pas, explicitement ou par un acte. C’est la fin politique que définit Clausewitz dans le premier chapitre du livre I de son ouvrage. Il ne faut donc pas voir dans la guerre un prétexte pour manifester la violence. Il faut y voir un temps particulier où non seulement il y a une volonté avérée de se combattre de façon armée pour reprendre la thèse de Hobbes dans le chapitre 13 du Léviathan (1651) mais également une réalité des combats. Sans eux, parler de guerre est abusif. Même la fameuse guerre froide entre les grandes puissances était accompagnée de guerres réelles (Corée, Viêt-Nam, etc.). Tout engagement violent différent n’est pas une guerre, c’est un état de violence pour parler comme Frédéric Gros (né en 1965) dans États de violence. Essai sur la fin de la guerre (2006). Il se caractérise par l’impossibilité de tracer une limite entre la guerre et la paix. À l’inverse, la guerre à proprement parler trace d’elle-même sa frontière radicale avec la paix. Ainsi, dans le roman de Barbusse, Volpatte pense que les embusqués de l’arrière sont en paix (IX La grande colère). La participation au combat constitue l’essence même de la guerre. Un soldat anonyme dans le dernier chapitre donne comme sens de la guerre, la paix (XXIV L’aube), preuve qu’elle a bien une fin qui n’est pas la seule destruction de l’État ennemi. Dans Les Perses, l’éloignement des hommes partis regrettés par les femmes montre justement la différence de nature entre la paix et la guerre (v.61-63).
Même s’il n’y a pas de possibilité de fixer des règles à la guerre sans se contredire dans la mesure où la situation appelle la violence – et un ennemi désarmé à qui on laisse la vie sauve peut à n’importe quel moment reprendre les armes – elle n’est ni simplement la relation entre des entités politiques qui veulent se détruire comme le pensait Rousseau ni pure violence comme le soutient René Girard dans son ouvrage, Achever Clausewitz. D’un côté, en effet, chacune des entités politiques a ses propres fins. Elles peuvent être purement défensives. Une fois la paix obtenue – et qu’elle ne soit pas perpétuelle importe peu ici – il est clair que l’essentiel est obtenu. La destruction de l’État ennemi peut être un moyen d’obtenir la paix dans les conditions voulues par rapport au motif du déclenchement de la guerre. C’est ainsi que l’empire perse n’est pas absolument ruiné par sa défaite malgré l’expression de cette crainte. Et la suite de l’histoire a été sa destruction. Mais l’État impérial d’Iran du Shah se pensait comme sa continuation. Les motifs de guerre qu’expriment les soldats dans leur diversité le montrent. Clausewitz exprime justement une multiplicité de fins politiques qui montrent que la fin de la guerre est d’obtenir par la violence la réalisation d’un but politique qui ne peut être atteint autrement. La simple observation armée est une forme de guerre. C’est pour cela que sa thèse fameuse selon laquelle « la guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens » n’est pas un retrait par rapport à l’analyse de la violence, mais le résultat d’une attention à la complexité du réel dans les relations humaines.
Disons pour conclure que le problème était de savoir s’il était possible de penser que la guerre a pour seule fin la destruction de l’État ennemi comme Rousseau le soutient dans le chapitre IV du livre I Du Contrat social. Il est apparu que la guerre avait bien cette fin et qu’on pouvait jusqu’à un certain point y ramener toutes les autres fins s’il est vrai qu’en l’absence de destruction de l’État ennemi, l’état de guerre ne cesse pas. Ce qui revient à dire avec Kant dans Vers la paix perpétuelle (1795) qu’il n’y a de paix véritable que définitive. Pourtant la guerre manifeste une violence qui donne à penser que le motif politique n’est peut-être qu’un prétexte et qu’au fond, ce n’est pas la destruction de l’État ennemi, mais la destruction de l’autre homme qui est le fonds de la guerre. Il n’en reste pas moins vrai qu’il faut distinguer entre les états de violence et la guerre. Ce qui permet de la comprendre, c’est bien sa finalité politique parmi lesquelles se trouve, et Rousseau avait raison sur ce point, la destruction de l’État ennemi au sens du changement de ce qu’il est à un moment donné, c’est-à-dire sa transformation ou sa subordination, etc.
[1] Hugo Grotius (1583- 1645) juriste néerlandais, auteur du De iure belli ac pacis (Du Droit de la guerre et de la paix, 1625). Le passage se situe au livre I, chapitre III, § 8.
[2] François Rabelais (1483 ou 1494-1553), auteur notamment de Pantagruel et de Gargantua.
[3] Rousseau se réfère implicitement à un épisode célèbre de l’Odyssée (chant IX) d’Homère.
[4] Rousseau fait allusion à Hobbes (1588-1679) qui soutient cette thèse dans Le Citoyen (1642) et le Léviathan (1651), le juriste et philosophe Pufendorf (1632-1694) et Jean Barbeyrac (1674-1744), traducteur et commentateur de Pufendorf et de Grotius.
[5] 1214-1226-1270, dit Saint Louis. Concernant les guerres privées, il a tenté de les limiter à défaut de pouvoir les interdire. Rousseau critique le fait vrai que Louis IX a légiféré en ce domaine. Quant à la paix de Dieu, cet appel contre les guerres privées de l’aristocratie, elle venait de l’Église et existait avant Louis IX.
[6] Mot construit sur le grec ancien πολιτεία, politéia, qui désigne soit la constitution, soit selon Aristote la forme droite du gouvernement du grand nombre dont la forme dégénérée est la démocratie (cf. Politique, III, 7).
Ne pas tenir compte des notes dans le résumé.
Pour aller plus loin : consultez les documents du site
Date de dernière mise à jour : 30/04/2021